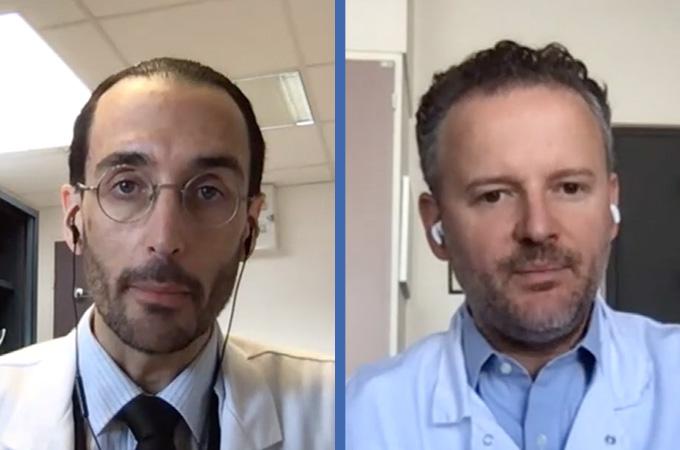Urologie
Cancer de la prostate : un test de dépistage polygénique plus fiable que le PSA
La détection précoce du cancer de la prostate peut sensiblement améliorer la survie. D’après l’étude BARCODE1, cibler les 10 % d’hommes les plus à risque, selon un score génétique polygénique salivaire, permettrait d’identifier davantage de tumeurs nécessitant un traitement qu’avec le PSA ou l’IRM seuls.

- undefined/istock
Le cancer de la prostate est un problème majeur de santé publique, représentant plus de 375 000 décès annuels dans le monde et environ 9 000 en France chaque année. Détectée à temps, la maladie bénéficie d’une survie à cinq ans proche de 100 %. Toutefois, le test PSA, principale modalité de dépistage, présente un taux élevé de faux positifs et peut conduire à un surdiagnostic et à des traitements inutiles. Face à ce constat, l’équipe de l’étude BARCODE1, dont les résultats sont publiés dans le New England Journal of Medicine, propose d’adopter une stratégie de dépistage ciblée selon le risque génétique, calculé à partir d’un test salivaire détectant 130 variants associés au cancer de la prostate.
Dans cette étude réalisée au Royaume-Uni, plus de 6 300 hommes âgés de 55 à 69 ans ont eu un « score polygénique » déterminé à partir de leur ADN salivaire. Parmi eux, 745 (11,7 %) étaient dans le percentile le plus élevé de risque et ont été invités à passer une IRM multiparamétrique, puis une biopsie systématique transpérinéale, quels que soient leurs taux de PSA. Les résultats montrent que 40 % des hommes biopsiés ont un cancer de la prostate, dont 55,1 % (soit 21,4 % du total diagnostiqué) classés en « risque intermédiaire défavorable » ou supérieur (score de Gleason ≥7 selon la classification NCCN). Fait notable, 71,8 % de ces tumeurs n’auraient pas été détectées avec le seul parcours diagnostique habituel basé sur un seuil de PSA.
Forte corrélation entre prédisposition génétique et forme agressive de la maladie
Au sein de la cohorte dépistée, on relève un taux élevé de lésions cliniquement significatives chez les patients dans le décile supérieur du score polygénique, montrant une forte corrélation entre prédisposition génétique et forme agressive de la maladie. En comparaison, le traditionnel seuil de PSA >3 µg/L employé dans d’autres travaux (notamment l’ERSPC) affiche un rendement diagnostique moins élevé, avec un risque important de laisser passer des cancers évolutifs.
Par ailleurs, le taux potentiel de surdiagnostic (tumeurs Gleason 6) se situe autour de 15–20 %, un chiffre semblable aux grands essais de dépistage par PSA. La démarche n’a pas engendré d’overtreatment majeur, la plupart des tumeurs à faible risque relevant d’une surveillance active. Le taux d’acceptation (62,8 %) pour réaliser IRM et biopsie, bien que satisfaisant, a été probablement freiné par la pandémie et la crainte d’une procédure invasive.
Un test basé sur l'ADN salivaire et 130 variants associés au risque
Les investigateurs ont extrait l’ADN salivaire de volontaires recrutés dans des centres de soins primaires. Le score génétique a été construit à partir de variants confirmés par des études de type genomewide association, puis interprété en pourcentage de risque. Les participants classés dans le 90e percentile ou plus ont bénéficié d’une IRM systématique suivie d’une biopsie, indépendamment de leur PSA ou d’un toucher rectal anormal. Cette approche, limitée aux hommes d’ascendance européenne dans la présente étude, reste à valider chez des populations plus diverses, notamment celles ayant un risque naturellement plus élevé (personnes de descendance africaine).
Selon les auteurs, ces données ouvrent la voie à un dépistage personnalisé : un test salivaire, réalisable une seule fois, permettrait de déterminer qui devrait bénéficier d’investigations approfondies avant l’apparition de signes cliniques. Cette stratégie plus précise pourrait réduire à la fois les faux positifs et les cas non diagnostiqués, tout en améliorant le rapport coût-efficacité. Les travaux futurs devront établir l’âge optimal d’introduction du score polygénique, définir le seuil exact de risque justifiant une IRM ou une biopsie et tenir compte des polymorphismes rares (ex. BRCA2). En somme, l’approche « risque génétique » pourrait réorienter les politiques de santé vers un dépistage ciblé et potentiellement plus rentable, dans l’objectif de réduire la mortalité liée à cette pathologie redoutable.