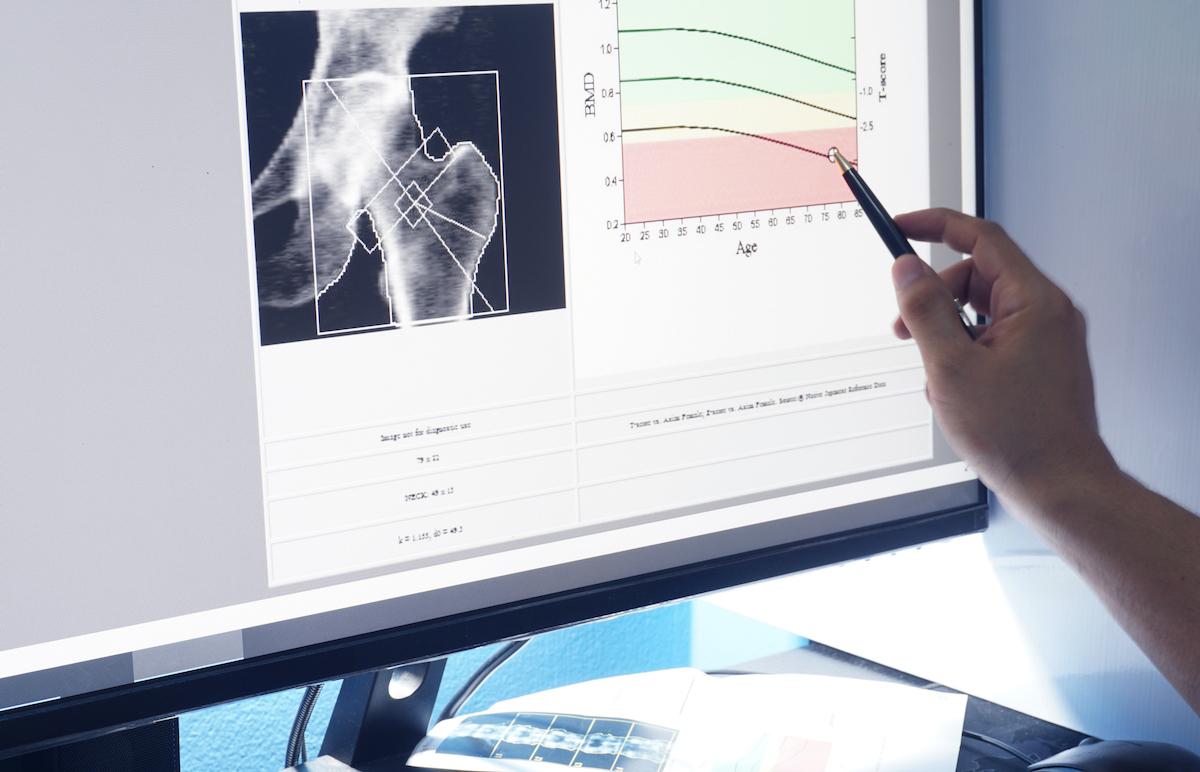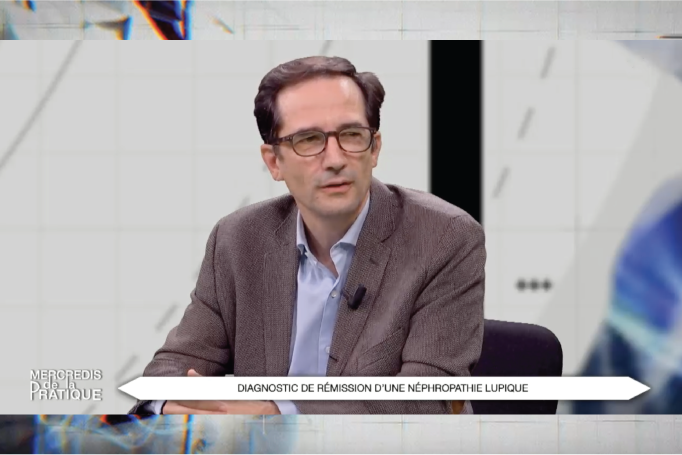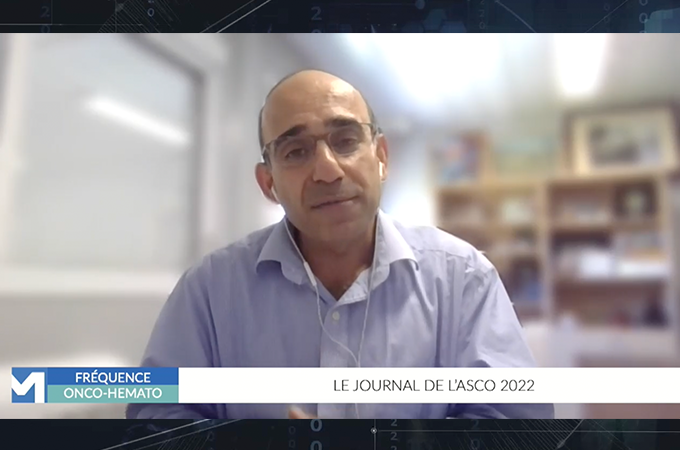Rhumatologie
Hypophosphatasie : les chercheurs se rapprochent de la thérapie génique
Une thérapie génique utilisant un vecteur viral AAV8-TNAP-D10 pourrait corriger durablement les conséquences osseuses et dentaires de l’hypophosphatasie (HPP) et réduire le fardeau du traitement substitutif actuel. Les études précliniques suggèrent une dose-réponse clairement définie et dépendante du sexe.

- Ivan-balvan/istock
L’hypophosphatasie (HPP) est une maladie génétique rare, liée à un déficit en Tissue-nonspecific alkaline phosphatase (TNAP). Ses manifestations vont d’une forme infantile, parfois létale peu après la naissance, à une forme plus tardive marquée par des fractures récidivantes et une perte dentaire prématurée. Depuis dix ans, la seule option thérapeutique repose sur des injections fréquentes d’enzyme de remplacement (asfotase alpha), une solution qui s’avère certes salvatrice pour nombre de patients, mais demeure très contraignante avec des effets secondaires conduisant à des abandons de traitement. Afin de pallier ces limites, l’équipe de recherche a développé un vecteur viral (AAV8) exprimant la TNAP « minéral-ciblée » (AAV8-TNAP-D10).
Dans cette étude, publiée dans JBMR, ils ont procédé à des injections uniques et à des doses croissantes dans deux modèles murins : le modèle infantile (Alpl-/-) et le modèle tardif (AlplPrx1/Prx1). Ils ont montré qu’aux posologies élevées (jusqu’à 4×10-10 vg/b dans la forme infantile), l’activité phosphatase sérique s’est élevée nettement, tandis que le pyrophosphate (PPi) diminuait. L’analyse radiographique et la microtomographie (μCT) confirment une correction quasi complète du phénotype osseux. Dans la forme tardive, les femelles ont bénéficié d’une restitution osseuse à partir de 4×10-8 vg/b, alors que les mâles nécessitaient des doses plus importantes (4×10-9 vg/b) pour une amélioration partielle. Ces résultats démontrent la faisabilité d’une approche génique pour l’HPP, en identifiant des fourchettes de doses permettant d’atteindre la correction souhaitée des anomalies tout en limitant les effets indésirables.
Une différence de réponse entre mâles et femelles
Dans le modèle tardif AlplPrx1/Prx1, on a observé une différence de réponse notable entre femelles et mâles. Les premières présentaient une forte expression de la protéine D10 dans les muscles, siège de l’injection, et un retour à une minéralisation osseuse satisfaisante. En revanche, chez les mâles, le vecteur semblait s’exprimer davantage dans le foie, provoquant une amélioration moins marquée du squelette. Les mécanismes exacts demeurent incertains, mais cette distribution tissulaire divergente s’est associée à une réponse inflammatoire plus prononcée chez les mâles, comme le suggère l’analyse protéomique sérique.
Les chercheurs ont également mis en évidence de rares calcifications ectopiques à des doses élevées, aussi bien dans le modèle infantile que tardif, ce qui confirme la nécessité de calibrer précisément le protocole pour éviter ces dépôts pathologiques. Malgré tout, le bilan global de tolérance reste favorable et les résultats soutiennent l’idée qu’une injection unique de vecteur AAV8-TNAP-D10 pourrait remplacer les multiples injections d’enzyme de remplacement, en particulier chez les patients les plus sévèrement atteints.
Un travail de faisabilité sur un modèle murin
Pour mener ce travail, les auteurs ont utilisé deux souches murines reproduisant fidèlement les phénotypes sévère (infantile) et tardif (adulte) de l’HPP. Les doses ont été administrées par voie intramusculaire, puis on a réalisé un suivi multiparamétrique. Les échantillons ont été analysés par radiographie, micro-CT, immunohistochimie (pour localiser la protéine D10) et dosage enzymatique (pour surveiller l’activité TNAP et le PPi). Cette diversité d’approches expérimentales, couplée à l’examen de deux modèles distincts et de sous-groupes selon le sexe, renforce la robustesse des données et leur pertinence en vue d’essais cliniques.
Selon les auteurs, ces résultats constituent un point de départ pour élaborer un protocole de thérapie génique adapté à l’humain. Ils suggèrent qu’il est possible de déterminer une posologie d’AAV8-TNAP-D10 permettant d’obtenir une correction osseuse et dentaire significative. Les premières études cliniques devront toutefois garder à l’esprit les variations possibles liées au sexe, à la tolérance hépatique et aux risques de calcifications ectopiques. Dans l’ensemble, la thérapie génique se profile comme une alternative prometteuse à l’enzyme de substitution, capable d’apporter une solution plus durable et moins invasive à l’hypophosphatasie. L’enjeu consistera, à long terme, à mieux comprendre les mécanismes de distribution du vecteur et à anticiper la prise en charge complète des patients, notamment sur les organes extra-squelettiques potentiellement touchés par ce déficit enzymatique.