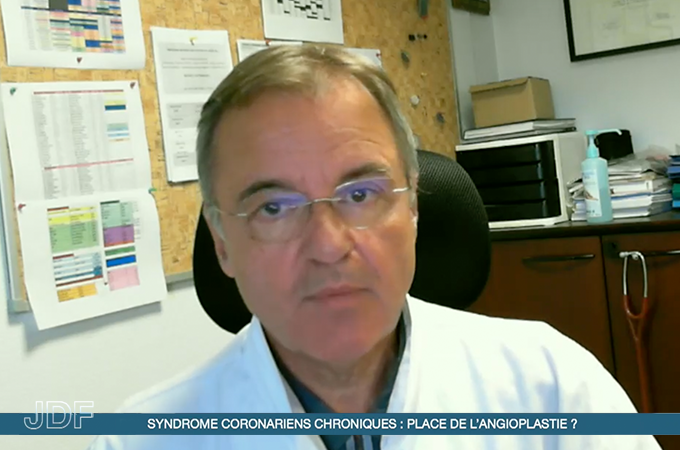Rhumatologie
Lombalgie chronique : les infiltrations doivent être discutées sur des arguments forts
Les résultats d’une méta-analyse en réseau portant sur 81 essais contrôlés randomisés suggèrent que, pour la plupart des patients souffrant de lombalgies et cervicalgies chroniques (non liées au cancer), les infiltrations de corticoïdes avec ou sans anesthésiques et autres procédures interventionnelles, n’apportent pas de soulagement significatif de la douleur par rapport à des procédures placebo (sham).

- Natali_Mis/istock
La lombalgie chronique, définie par une symptomatologie persistante depuis plus de trois mois en l’absence de cancer, représente un défi de santé publique majeur. Son impact socio-économique est considérable, avec des prévalences estimées variant de 4 à 20 % pour les lombalgies et d’environ 3 à 4,5 % pour les cervicalgies, ainsi qu’un coût économique disproportionné.
Dans plusieurs régions du globe, notamment en Amérique du Nord, il est fréquent de recourir à des approches interventionnelles (injections épidurales de corticoïdes, bloc des branches médiales facettaires, radiofréquence….) pour traiter ce type de douleur. Cependant, les recommandations professionnelles apparaissent discordantes : certaines sociétés savantes les déconseillent, tandis que d’autres les promeuvent.
Une large méta-analyse en réseau sur des études randomisées
Afin de clarifier l’efficacité comparative de ces interventions, une revue systématique avec méta-analyse en réseau (NMA), publiée dans The BMJ, a inclus 81 essais contrôlés randomisés portant sur 7977 patients. Les chercheurs ont exploré 13 types de procédures interventionnelles (seules ou en association), comparées à des interventions simulées (sham) ou à des soins usuels. Les résultats montrent, avec un niveau de certitude allant de faible à modéré selon les interventions, que la majorité des injections (épidurales ou intramusculaires, avec ou sans stéroïdes) et certaines techniques de radiofréquence ne procurent pas de réduction substantielle de la douleur rachidienne chronique par rapport à une procédure placebo.
Dans le cas spécifique de l’association d’une rachialgie chronique à des douleurs radiculaires (lombosciatique ou cervicobrachialgies chroniques), les infiltrations de corticoïdes n’améliorent pas non plus significativement les scores de douleur ou de fonction. La radiofréquence du ganglion spinal semble, elle aussi, n’apporter qu’un bénéfice minime, lorsqu’elle est comparée à une procédure simulée.
Moins d’un point de différence entre les infiltrations et les procédures placebo
Dans le détail, les estimations ponctuelles des différences de douleur (généralement évaluées sur une échelle visuelle analogique allant de 0 à 10) montrent souvent moins d’un point de variation entre les gestes interventionnels et les interventions placebo. Par exemple, pour les douleurs axiales lombaires, on observe qu’une injection épidurale d’anesthésique et de corticoïde aboutit à une différence moyenne autour de 0,2 à 0,3 cm sur l’échelle de douleur, ce qui n’est pas cliniquement pertinent. Des résultats similaires concernent les blocs facettaires, qu’ils comprennent ou non des corticoïdes.
Les analyses en sous-groupes (axial vs radiculaire) révèlent également peu de bénéfices tangibles, quelle que soit la procédure, bien que le niveau de preuves varie. Par ailleurs, tous les types d’interventions étudiés ont un certain profil d’effets indésirables : réactions locales, risque d’infection, complications neurologiques (rarement), ou effets systémiques liés aux corticoïdes. Toutefois, l’évaluation de la tolérance reste globalement de faible ou de très faible certitude ; il n’a pas été possible de tirer des conclusions fermes sur le risque absolu d’événements indésirables.
Une méta-analyse en réseau sur des études randomisée
Cette synthèse repose sur une recherche documentaire exhaustive menée dans plusieurs bases (Medline, Embase, CINAHL, CENTRAL, Web of Science), jusqu’au 24 janvier 2023. Les investigateurs ont recensé 132 études pertinentes avant de sélectionner 81 essais pour la méta-analyse, en vérifiant rigoureusement le risque de biais et la qualité méthodologique. L’approche GRADE a été utilisée pour grader le niveau de certitude des résultats, et des réseaux d’analyses ont permis de comparer indirectement plusieurs types de procédures lorsqu’elles n’avaient pas été confrontées directement dans les essais.
Selon les auteurs, cette revue conduit à remettre en question le bénéfice réel de nombreuses interventions invasives dans la douleur chronique du rachis. Si certains patients peuvent rapporter un soulagement transitoire, la plupart des données suggèrent que l’amélioration est faible, voire inexistante, par rapport à une procédure placebo. Les médecins et spécialistes de la douleur pourraient donc privilégier des approches moins invasives et mieux étayées, en tenant compte des préférences du patient et d’une éventuelle réévaluation régulière.
Une approche nécessairement multimodale de la lombalgie chronique
C’est la tendance actuelle en France où, au-delà d’une approche thérapeutique multimodale de la lombalgie chronique (kinésithérapie intensive, antalgiques adaptés, soutien psychologique, réentrainement à l’effort…), une IRM peut être pertinente avant d’infliger quelque geste que ce soit. Seule l’inflammation visualisée en IRM (ou en scintiscanner), si elle est cohérente à la douleur, a des chances raisonnables d’être améliorée par les infiltrations.
Quant aux blocs de branches ou à la radiofréquence, ou même la stimulation médullaire, les résultats des différentes études, très discordants, imposent de répartir de manière plus fines les différents groupes de malades dans des essais randomisés de haute qualité, comparant notamment ces procédures à d’autres stratégies (kinésithérapie intensive, exercices de stabilisation, traitement multimodal...).
Enfin, l’évaluation approfondie des événements indésirables et l’impact sur la qualité de vie devraient être mieux pris en compte, afin d’optimiser la décision médicale partagée et de mieux cibler les patients susceptibles d’en retirer le plus de bénéfices.