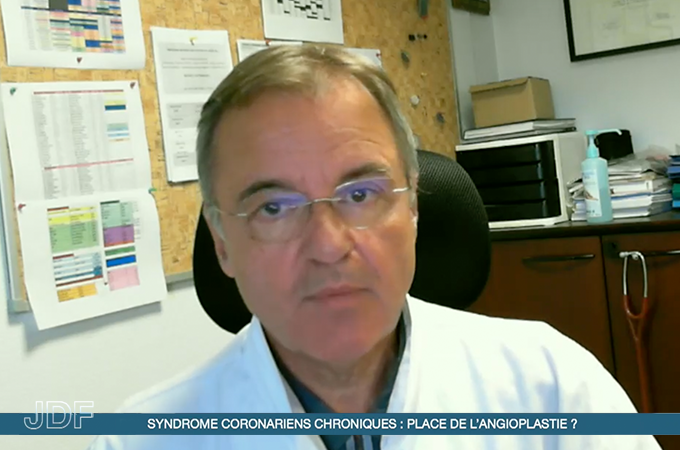Gynéco-obstétrique
Exposition prénatale à l’alcool : un impact même à faible dose sur la morphologie faciale
Même à faible dose ou dose modérée, l’exposition prénatale à l’alcool modifierait subtilement la forme du visage chez l’enfant jusqu’à 6-8 ans. Ces variations, localisées autour du nez et des yeux, ne suivent pas un gradient linéaire avec la dose.

- NataliaDeriabina/istock
Les diagnostics de syndrome d’alcoolisation fœtale (FAS) ou de syndrome partiel (pFAS) reposent classiquement sur trois traits faciaux dits « sentinelles » (philtrum aplati, fentes palpébrales raccourcies et lèvre supérieure amincie), associés à des altérations neurodéveloppementales. Pourtant, des variations plus subtiles de la morphologie du visage pourraient survenir dès de faibles expositions prénatales à l’alcool (EPA) et persister jusqu’à l’âge scolaire.
Dans le cadre d’une étude de cohorte prospective menée à Melbourne (Australie), et dont les résultats sont publiés dans JAMA Pediatric, les visages de 549 enfants (dont 235 évalués à deux reprises) ont été analysés par imagerie 3D à 12 mois puis à 6-8 ans. Les résultats révèlent qu’une faible exposition prénatale à l’alcool, même limitée au premier trimestre, s’associe à des changements discrets de la région nasale et oculaire. Ces altérations persistent chez l’enfant d’âge scolaire, suggérant un effet biologique durable, bien que les visages étudiés ne présentent pas les caractéristiques typiques des formes cliniques de syndrome d’alcoolisation fœtale.
Pas de relation linéaire avec la dose d’alcool
L’analyse segmentée de 63 zones faciales distinctes confirme la robustesse de l’association entre EPA et forme des yeux et du nez. Les comparaisons de sous-groupes, selon qu’il y ait eu consommation seulement au premier trimestre ou plus longtemps, montrent un impact similaire sur la morphologie faciale, sans relation clairement linéaire avec la dose d’alcool.
En revanche, l’étude n’observe pas de différence notable en termes de tolérance ou de complications cliniques immédiates chez les enfants exposés. Parallèlement, les variations faciales détectées diffèrent de celles observées chez des enfants atteints de FAS/pFAS, ce qui laisse penser qu’il existe des mécanismes potentiellement non continus entre l’exposition faible/modérée et la forte exposition ayant conduit aux tableaux cliniques sévères.
Une méthodologie basée sur une acquisition d’images 3D
Sur le plan méthodologique, l’acquisition d’images 3D à deux reprises (12 mois et 6-8 ans) et l’usage de techniques avancées d’analyse morphométrique (incluant la segmentation hiérarchique et des méthodes supervisées) renforcent la fiabilité des résultats. Le recrutement de femmes enceintes dans des centres de maternité publics, ainsi que la standardisation des mesures, visait à obtenir un échantillon représentatif de la population générale, bien que l’analyse se soit focalisée sur des enfants d’ascendance européenne pour réduire l’hétérogénéité ethnique.
Selon les auteurs, ces données soulignent l’importance de sensibiliser aux effets d’une consommation, même ponctuelle ou modérée, d’alcool pendant la grossesse : des modifications faciales durables peuvent se manifester en l’absence de signes neurodéveloppementaux ou dysmorphiques sévères.
L’abstinence complète est nécessaire pendant la grossesse
Depuis 2009, les recommandations australiennes - et accessoirement françaises - préconisent une abstinence totale pendant la grossesse. Pourtant, plus d'une femme enceinte sur quatre (28 %) continue de consommer de l'alcool une fois la grossesse confirmée, notamment en raison du manque de preuves formelles sur les effets de faibles doses.
Les messages de santé publique doivent s'adapter aux différents profils de mères, rappellent les chercheurs dans un communiqué . Pour les femmes ayant une consommation contrôlée, il s'agit de renforcer l'information sur les risques potentiels. Pour celles en situation de dépendance, un soutien plus spécifique est nécessaire. En attendant, la meilleure approche pour préserver la santé du bébé reste l'abstinence totale.