Cardiologie
Infarctus du myocarde : remise en cause de l’intérêt de la colchicine en prévention secondaire
L’inflammation est associée aux évènements cardiovasculaires et la piste anti-inflammatoire demeure une voie de recherche majeure dans la maladie coronarienne. Toutefois, l’essai CLEAR suggère qu’un traitement prolongé par colchicine après infarctus ne réduit pas significativement les événements cardiovasculaires.
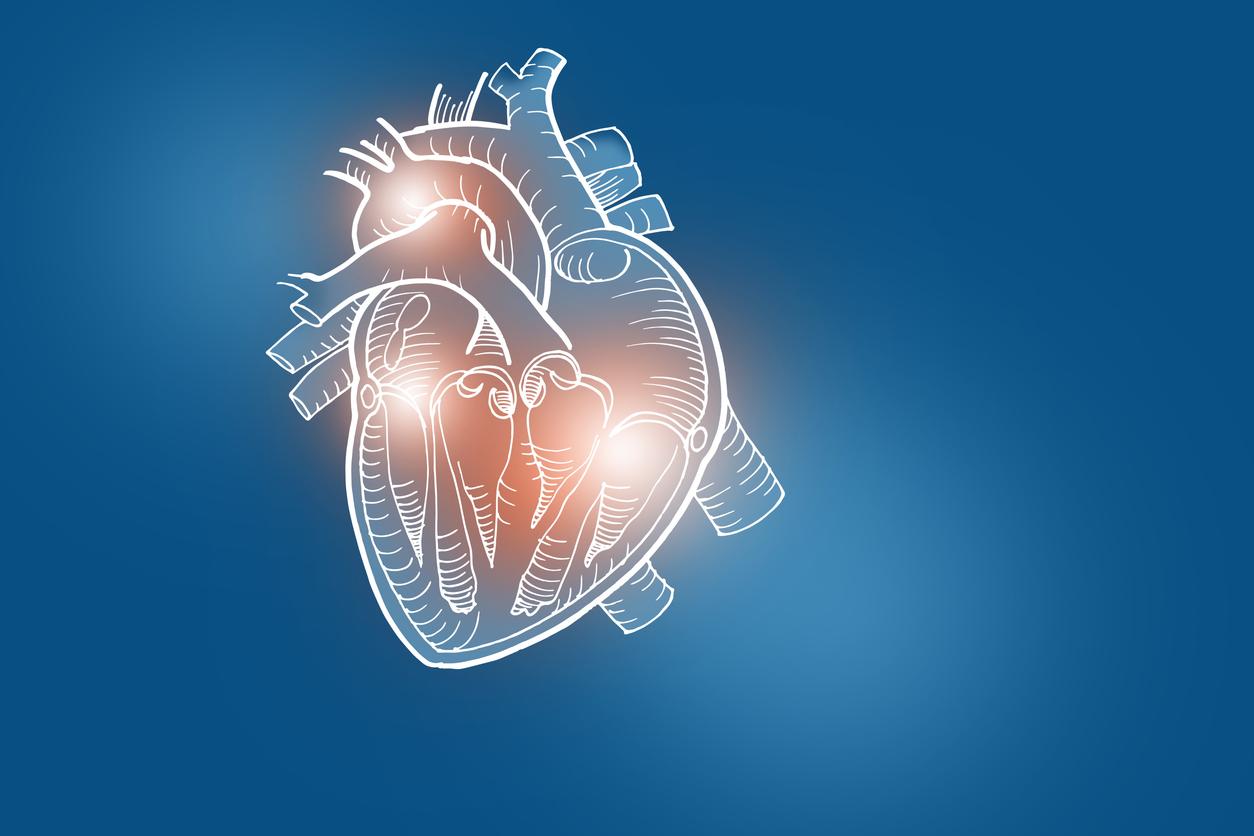
- mi-viri/istock
L’inflammation joue un rôle clé dans le développement de l’athérosclérose, aussi bien durant la phase aiguë que chronique. Des concentrations élevées de marqueurs inflammatoires circulants s’associent à un moins bon pronostic chez les patients souffrant d’un syndrome coronarien aigu. Des essais antérieurs avec des molécules anti-inflammatoires ont montré des bénéfices cardiovasculaires, notamment avec le canakinumab (inhibiteur de l’interleukine-1β) après un infarctus du myocarde, quoique ce traitement ait été associé à une augmentation du taux d’infections sévères.
De son côté, la colchicine, qui inhibe notamment l’action des neutrophiles et la libération de cytokines pro-inflammatoires (IL-1, IL-6), avait déjà fait l’objet d’études positives chez des patients récemment ou plus anciennement coronariens. Toutefois, des essais récents, conduits dans le contexte de l’AVC ischémique, n’ont pas confirmé une réduction des événements cardiovasculaires, soulevant la question de la durée de traitement et du profil de patients éligibles.
Un très large essai pour explorer l'intérêt de la colchicine
C’est dans ce contexte que l’essai CLEAR, un essai multicentrique randomisé en double aveugle, a recruté plus de 7000 patients ayant eu un infarctus du myocarde récent (moins de 30 jours). L’objectif principal était d’évaluer la survenue d’un critère composite incluant le décès d’origine cardiovasculaire, la récidive d’infarctus, l’accident vasculaire cérébral ou la revascularisation coronaire non programmée.
Dans la publication du New England Journal of Medicine, au terme d’un suivi médian de trois ans, aucun bénéfice statistiquement significatif n’a été observé (9,1% d’événements dans le bras colchicine vs 9,3% dans le bras placebo ; HR = 0,99 ; IC 95 % [0,85-1,16] ; p = 0,93). De manière cohérente, l’incidence de chaque évènement du critère principal composite est demeurée proche entre les deux groupes. Néanmoins, la colchicine permettrait de réduire le taux de CRP mesuré à 3 mois de 1,28 mg/L en moyenne (IC à 95 % [−1,81 à −0,75]), attestant d’un effet biologique anti-inflammatoire tangible.
Pas de différence non plus dans les sous-groupes
S’agissant des analyses de sous-groupes (notamment en fonction de l’âge, du sexe ou de la sévérité de la maladie coronarienne), aucune différence majeure n’a été détectée, y compris en tenant compte de l’impact éventuel de la pandémie de Covid-19. Avec 649 premiers événements rapportés, la puissance statistique de l’essai est jugée robuste.
Les données de tolérance montrent toutefois une augmentation notable de la diarrhée dans le groupe colchicine (10,2 % vs 6,6 % ; p < 0,001). En revanche, les infections sévères ne sont pas significativement accrues par ce traitement, contrairement à ce qui avait été observé avec le canakinumab. Les taux de décès d’origine non cardiovasculaire sont même légèrement inférieurs chez les patients sous colchicine par rapport au placebo, sans pour autant atteindre un seuil de significativité. Ainsi, la tolérance globale de la colchicine se révèle satisfaisante, à l’exception de ce surcroît d’effets digestifs.
Une large étude randomisée sur 7000 patients
L’essai CLEAR a utilisé un plan factoriel 2x2, comparant la colchicine au placebo, et simultanément la spironolactone au placebo, dans 14 pays et 104 centres investigateurs. Les patients, recrutés dans le mois suivant un infarctus du myocarde, ont été suivis sur une durée médiane de trois ans. Malgré la puissance apparente (plus de 7000 patients randomisés), l’échantillon reste sous-représenté pour certaines populations (femmes, groupes ethniques divers), limitant la généralisabilité des résultats. En outre, 26% des patients ont arrêté le traitement, un taux d’abandon plus important qu’escompté, même si les analyses en “per-protocol” ne modifient pas substantiellement les conclusions. Enfin, la dose quotidienne de 0,5 mg de colchicine n’exclut pas que d’autres posologies (par exemple en prises biquotidiennes) puissent produire des résultats différents, justifiant de futures recherches cliniques.
Selon les auteurs, ces données sont donc en contradiction avec les recommandations récentes de la Société Européenne de Cardiologie, qui avait promu la colchicine en classe IIa pour les coronariens. Les résultats de CLEAR n’incitent pas à intégrer systématiquement la colchicine dans la prise en charge post-infarctus. Néanmoins, la réduction constante de l’inflammation (notamment observée via la CRP) et l’absence d’augmentation des infections graves confortent l’importance du levier inflammatoire dans la cardiopathie ischémique.
D’autres voies thérapeutiques, ciblant différentes étapes de la cascade inflammatoire (interleukine-1β, interleukine-6, etc.), sont en cours d’évaluation, comme en témoigne l’essai ARTEMIS sur le ziltivekimab. Les divergences de résultats entre canakinumab, méthotrexate et colchicine soulignent la complexité de la réponse inflammatoire et la nécessité de nouveaux essais à large échelle. À ce stade, il reste primordial de personnaliser la prise en charge et d’affiner le phénotypage inflammatoire, afin de cibler au mieux les patients susceptibles de tirer un bénéfice réel de ce traitement anti-inflammatoire.

































