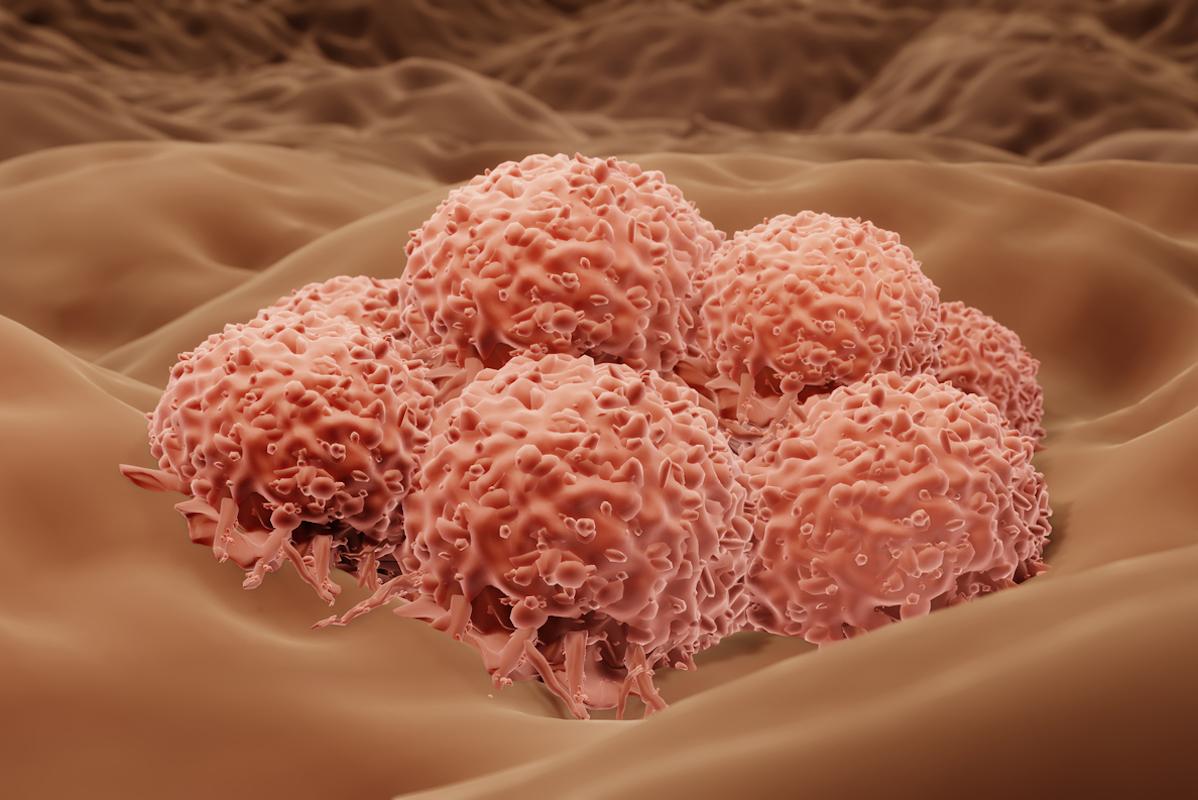Onco-Dermato
Mélanome et métastases cérébrales sous anti-PD1 : quid de l’association ipilimumab-nivolumab ?
Après progression sous anti-PD-1, l’association ipilimumab-nivolumab ont une réponse prometteuse pour certains profils de patients atteints de métastases cérébrales de mélanome. Bien que la proportion de répondeurs soit faible, ce traitement pourrait offrir une option thérapeutique complémentaire, en particulier en association avec des approches locales.
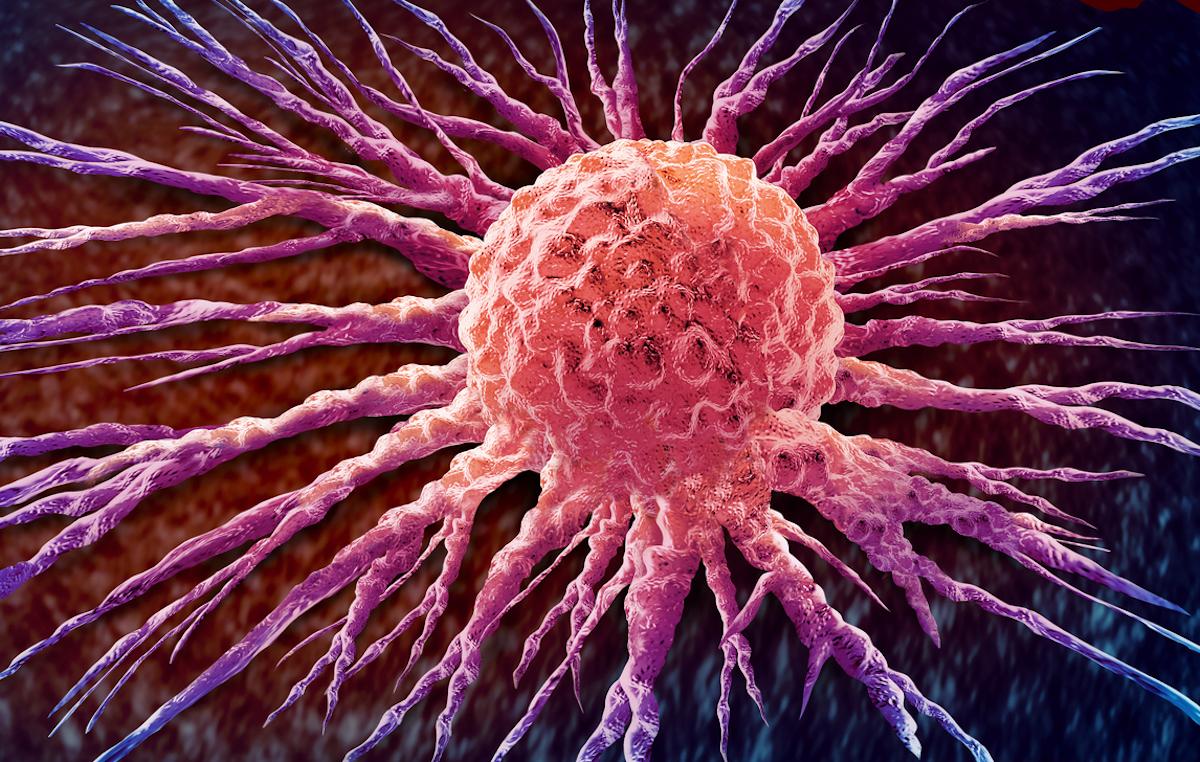
- wildpixel/istock
Les métastases cérébrales de mélanome constituent un défi thérapeutique majeur. Dans les formes asymptomatiques sans exposition préalable aux anticorps anti-PD-1, l’association ipilimumab-nivolumab affiche des taux de réponse intracrânienne allant de 44 % à 54 %. Les réponses obtenues peuvent parfois se maintenir sur le long terme. Cependant, l’efficacité intracrânienne de ce double blocage immunitaire chez les patients dont la maladie progresse déjà sous anti-PD-1 restait, jusqu’à récemment, inconnue. Avec le recours croissant aux immunothérapies néo-adjuvantes et adjuvantes anti-PD-1, il est devenu essentiel d’évaluer l’intérêt de l’association ipilimumab-nivolumab dans cette situation particulière.
Dans ce contexte, une étude rétrospective menée au Memorial Sloan Kettering, et publiée dans JAMA Oncology, sur 28 patients ayant développé des métastases cérébrales de mélanome progressives après traitement anti-PD-1 met en évidence un taux de réponse intracrânienne (ORR) de 11 % (IC à 95 %, 2 %-28 %) sous ipilimumab-nivolumab. Un taux plus faible qu’en première ligne mais il est à noter que parmi ces patients, deux cas de réponse complète et un cas de réponse partielle ont été observés.
La survie médiane sans progression intracrânienne (PFS) est estimée à 1,6 mois (IC 95 %, 1,2-4,4) et la survie globale médiane (OS) s’établit à 6,7 mois (IC 95 %, 3,6-10,0). Ces données soulignent la difficulté de contrôler la progression intracrânienne une fois la résistance au blocage PD-1 établie.
Certains patients sans exposition antérieure à l’ipilimumab ont obtenu une réponse soutenue
Au-delà de ce taux de réponse intracrânienne global de 11 %, l’étude rapporte plusieurs résultats secondaires. L’ORR extracrânienne s’élève ainsi à 14 % (IC 95 %, 4 %-33 %), confirmant la difficulté de contrôler l’ensemble des localisations métastatiques après un échappement initial à l’anti-PD-1. Dans la cohorte analysée (28 patients, âge médian de 64 ans), 18 avaient reçu une monothérapie anti-PD-1, tandis que 10 avaient déjà bénéficié d’ipilimumab auparavant. Les tumeurs proviennent majoritairement de mélanomes cutanés (79 %), les autres origines étant acrales (14 %) ou inconnues (7 %). À noter que la majorité des patients (64 %) présentaient plus de cinq lésions intracrâniennes, ce qui illustre la lourdeur de la charge tumorale. Par ailleurs, 14 % recevaient une corticothérapie à dose ≥4 mg de dexaméthasone par jour lors de l’instauration d’ipilimumab-nivolumab, et 14 % avaient une atteinte méningée associée.
Si la tolérance globale n’est pas détaillée en profondeur dans ce travail, on sait par ailleurs qu’une corticothérapie concomitante peut influencer la réponse immunitaire et parfois la tolérance. Les résultats semblent toutefois cohérents avec le profil de sécurité déjà connu pour l’association ipilimumab-nivolumab. Malgré le faible taux de réponse, il est important de souligner que certains patients (en particulier ceux ayant deux lésions intracrâniennes ou moins, sans exposition antérieure à l’ipilimumab) ont obtenu une réponse soutenue au-delà de six mois. Cela suggère l’importance d’une approche personnalisée, tenant compte du nombre de lésions, du statut de traitement antérieur et du recours potentiel à des traitements locaux (radiochirurgie, chirurgie).
Une analyse rétrospective monocentrique du Memorial Sloan Kettering
Les données présentées proviennent d’une analyse rétrospective monocentrique réalisée au Memorial Sloan Kettering (États-Unis) entre 2011 et 2023. Les patients inclus devaient présenter au moins une métastase cérébrale de diamètre ≥5 mm et n’avoir bénéficié d’aucune intervention locale préalable au niveau cérébral (notamment radiochirurgie). L’évaluation de la réponse intracrânienne reposait sur l’interprétation radiologique en imagerie par résonance magnétique (IRM) selon des critères adaptés (Modified RECIST), lorsque disponible, et sur les comptes rendus radiologiques ou l’interprétation clinique dans les autres cas. Bien que ce protocole rétrospectif ait reçu l’approbation du comité d’éthique local, l’unicité du centre et la taille modeste de l’échantillon (28 patients) limitent la généralisabilité des conclusions. Il est donc nécessaire de mener des études plus larges et si possible prospectives afin de mieux comprendre l’efficacité et la tolérance de cette combinaison thérapeutique après progression sous anti-PD-1.
Selon les auteurs, ces résultats plaident en faveur d’une utilisation ciblée de l’association ipilimumab-nivolumab dans les métastases cérébrales de mélanome résistantes à l’anti-PD-1, tout en soulignant l’importance cruciale des traitements locaux, en particulier la radiothérapie. À plus long terme, l’essor des immunothérapies (notamment néo-adjuvantes et adjuvantes) chez les patients atteints de mélanome, mais aussi d’autres types de tumeurs, justifie pleinement la réalisation d’essais cliniques dédiés. Les recherches futures devront s’attacher à mieux caractériser les facteurs de résistance à l’anti-PD-1, à optimiser la sélection des patients qui pourraient bénéficier de l’ajout d’ipilimumab et à évaluer l’intérêt de la combinaison avec d’autres approches, qu’elles soient loco-régionales ou systémiques.
En résumé, bien que l’efficacité intracrânienne d’ipilimumab-nivolumab après progression sous anti-PD-1 reste relativement faible (11 %), cette approche thérapeutique demeure prometteuse pour certains profils de patients. Les besoins en traitements complémentaires (radiothérapie ou chirurgie), associés à une meilleure compréhension des mécanismes de résistance immunologique, constituent des axes de recherche prioritaires pour améliorer la prise en charge des MBM.