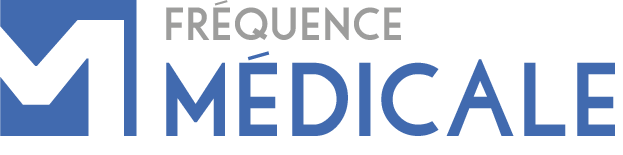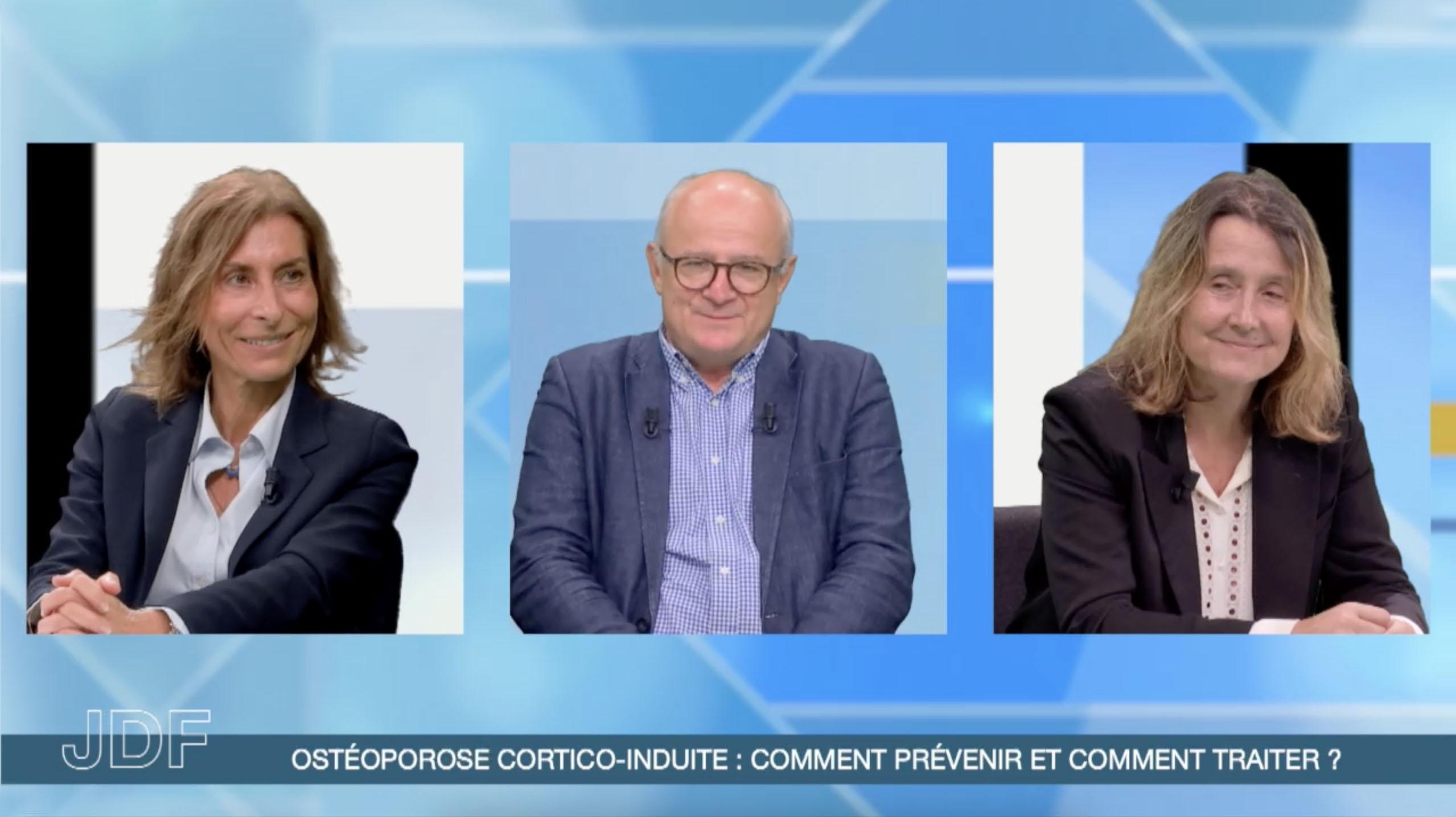Patients, internes, infirmiers…
Regards croisés sur l'hôpital
La tarification à l'activité, unique mode de financement des hôpitaux, a changé les rapports entre l'administration et les personnels médicaux. Soumis à une pression toujours plus forte, beaucoup sont à bout. Qu'ils soient patients, internes, médecins ou infirmiers, les reproches fusent.

Comme il soigne tout le monde, l’hôpital public est un bien précieux à chaque Français. Quand un souci de santé arrive, beaucoup ont encore le réflexe « Urgences ». Mais à cause de ce modèle dit « hospitalo-centré », les services sont bien souvent saturés et les personnels fatigués. « Le mammouth », comme ses détracteurs le surnomment, semble au bord de l’implosion. Même ceux qui l’aiment ne se gênent plus pour le critiquer allègrement. Il suffit de rencontrer n’importe quel patient, infirmer, interne, ou même, chef de service pour s’en apercevoir.
" En province, mieux vaut ne pas faire un infarctus le weekend "
 Âgé de 65 ans, René Mazars est un malade chronique. Atteint de polyarthrite, l’homme est habitué à fréquenter l’hôpital public. Jusque dans ses instances. Depuis 6 ans, il est membre du conseil de surveillance de l’hôpital de Rodez (Aveyron). Dedans, il entend souvent parler des plans de budget. « Des éléments structurels sur lesquels les 3 usagers qui siègent ont du mal à se faire entendre », avoue-t-il. Plus rageant encore, les économies sur le dos du patient. « A cause du manque de marge financière, le malade sert de plus en plus souvent de variable d’ajustement », dénonce-t-il. Cela passe par l’augmentation de certains packaging, « les fameux forfaits patients », qui excluent maintenant des personnes du champ de l’hôpital.
Âgé de 65 ans, René Mazars est un malade chronique. Atteint de polyarthrite, l’homme est habitué à fréquenter l’hôpital public. Jusque dans ses instances. Depuis 6 ans, il est membre du conseil de surveillance de l’hôpital de Rodez (Aveyron). Dedans, il entend souvent parler des plans de budget. « Des éléments structurels sur lesquels les 3 usagers qui siègent ont du mal à se faire entendre », avoue-t-il. Plus rageant encore, les économies sur le dos du patient. « A cause du manque de marge financière, le malade sert de plus en plus souvent de variable d’ajustement », dénonce-t-il. Cela passe par l’augmentation de certains packaging, « les fameux forfaits patients », qui excluent maintenant des personnes du champ de l’hôpital.

« La complémentaire santé pour tous ne concerne que les salariés », rappelle-t-il. Pour les patients qui n'en ont pas, restent donc à leur charge 20 % du séjour, plus la prestation complémentaire journalière. « Pour une personne âgée, au bout de 4-5 jours d’hospitalisation, on arrive vite à 8 000 euros ». On l’a compris, le poste patient dans le budget est souvent la source facile pour créer de nouvelles recettes. « On tape sur celui qui ne peut pas se défendre », estime René Mazars. Enfin, les inégalités se jouent parfois à un jour près. « Chez nous, comme dans beaucoup de territoires, mieux vaut ne pas être malade ou faire un infarctus le week-end. On a plus de risque de rester hémiplégique, voire pire », assure-t-il. Pendant ces deux jours, les Urgences sont bien souvent en sous-effectifs...
" Des amis internes sont tombés dans le burn-out, l'anorexie "
 Baptiste Beaulieu, ex-interne à l'Hôpital d'Auch (Gers). Dans son blog Alors Voilà (devenu le livre Les 1 001 vie des Urgences), l'ancien interne en médecine a raconté cette réalité. Celle d’un jeune homme plongé dans la vie trépidante des Urgences du petit hôpital public d’Auch (Gers). « J’ai adoré le travail en équipe, même si parfois c’était dur. A cause des conditions de travail, certains amis sont tombés dans la dépression, le burn-out ou l’anorexie. Ils avaient le sentiment de ne pas pouvoir répondre à tout ce qu’on leur demandait ».
Baptiste Beaulieu, ex-interne à l'Hôpital d'Auch (Gers). Dans son blog Alors Voilà (devenu le livre Les 1 001 vie des Urgences), l'ancien interne en médecine a raconté cette réalité. Celle d’un jeune homme plongé dans la vie trépidante des Urgences du petit hôpital public d’Auch (Gers). « J’ai adoré le travail en équipe, même si parfois c’était dur. A cause des conditions de travail, certains amis sont tombés dans la dépression, le burn-out ou l’anorexie. Ils avaient le sentiment de ne pas pouvoir répondre à tout ce qu’on leur demandait ».
Certains de ces futurs médecins franchissaient même fréquemment la ligne rouge, avec des cas de maltraitance médicale : « On se retrouve à faire attendre une patiente de 80 ans pendant 5, 6, voire 7 heures sur un brancard ». Mais l’homme a aussi assisté à des cas de maltraitance venant de l’administration : « Avec des télés enlevées à des patients en fin de vie parce que leur famille n’avait pas payé l’abonnement. Je l’ai vu très très souvent », assure-t-il. Des images qu’il n’oubliera pas, comme celles de familles se recueillant sur le corps de leur défunt dans des couloirs, faute d’une chambre. Pour toutes ces raisons, Baptiste Beaulieu a fait le choix d’aller exercer en ville, « où le rapport et la communication avec les patients sont plus humains ».

Mais en cabinet, le généraliste souffre maintenant de la solitude de l'exercice isolé. C’est pourquoi il envisage parfois de retourner aux Urgences. « Le côté aigüe des pathologies qu'on supporte grâce au rire salvateur en équipe me manque ». La preuve sans doute que la flamme n'est pas tout à fait éteinte...
" Même pour une petite décision tout est difficile et long "
 Michaël Peyromaure, chef du service d'urologie à l'Hôpital Cochin. Mais ces futurs médecins surmenés ne sont pas les seuls. Tout en haut de la hiérarchie médicale hospitalière, c'est le même sentiment qui prédomine. Alors qu’il s’était engagé dans la service public hospitalier, il y a quinze ans, pour son attractivité, le Pr Michaël Peyromaure pointe aujourd’hui de nombreux dysfonctionnements : « Dans sa globalité l’hôpital tient sur ses fondements, mais je pense que la qualité des soins a baissé ces dernières années ».
Michaël Peyromaure, chef du service d'urologie à l'Hôpital Cochin. Mais ces futurs médecins surmenés ne sont pas les seuls. Tout en haut de la hiérarchie médicale hospitalière, c'est le même sentiment qui prédomine. Alors qu’il s’était engagé dans la service public hospitalier, il y a quinze ans, pour son attractivité, le Pr Michaël Peyromaure pointe aujourd’hui de nombreux dysfonctionnements : « Dans sa globalité l’hôpital tient sur ses fondements, mais je pense que la qualité des soins a baissé ces dernières années ».
Pour lui, l’hôpital est tout simplement le reflet de ce qui se passe dans le pays, « géré de manière trop centralisé et bureaucratique ». « Il y a une absence d’adaptation aux besoins concrets des soignants et des malades », déplore-t-il. « Pour la moindre petite décision tout devient difficile et long », ajoute-t-il. Et la liste de reproches à l’encontre de l’administration n'en finit plus. Malgré tout, le Pr Peyromaure pense rester à l’AP-HP, en espérant qu’il va redevenir agréable d’y travailler, « parce que ce qu’on fait est utile », pense-t-il.
" Avant, je faisais mieux en matière de sécurité des soins "
 Olivier Youinou, infirmier anesthésiste à l'Hôpital Henri-Mondor (Créteil). Enfin, les premiers témoins de la souffrance médicale sont sans doute les soignants, et certains ont décidé de ne plus rester dans l'ombre. Pour se faire entendre, ce syndicaliste à Sud Santé a décidé de rejoindre le mouvement « Nuit Debout ». Depuis plus d'une semaine, il a monté la commission santé de l'organisation surnommée « Hôpital Debout ». D'après les habitués de la Place de la République (Paris), elle ferait de plus en plus entendre sa voix. Menées par une trentaine de personnels hospitaliers, les dernières AG auraient rassemblé jusqu’à 300 auditeurs. Avec à chaque fois, le même leitmotiv : dénoncer les conditions de travail des personnels soignants à l’hôpital public.
Olivier Youinou, infirmier anesthésiste à l'Hôpital Henri-Mondor (Créteil). Enfin, les premiers témoins de la souffrance médicale sont sans doute les soignants, et certains ont décidé de ne plus rester dans l'ombre. Pour se faire entendre, ce syndicaliste à Sud Santé a décidé de rejoindre le mouvement « Nuit Debout ». Depuis plus d'une semaine, il a monté la commission santé de l'organisation surnommée « Hôpital Debout ». D'après les habitués de la Place de la République (Paris), elle ferait de plus en plus entendre sa voix. Menées par une trentaine de personnels hospitaliers, les dernières AG auraient rassemblé jusqu’à 300 auditeurs. Avec à chaque fois, le même leitmotiv : dénoncer les conditions de travail des personnels soignants à l’hôpital public.
« Il y a 20 ans, quand j’ai commencé en bloc opératoire, nous étions un médecin anesthésiste et un infirmier anesthésiste dans chaque salle d’opération. Aujourd’hui, on a un médecin pour deux, trois, voire quatre salles ». Résultat, une fois la machine anesthésique lancée, l’infirmier est le seul à la tête du patient. Du début de l’intervention jusqu’au réveil. « Alors que je suis plus expérimenté maintenant, j’ai l’impression d’avoir mieux fait en début de carrière en matière de sécurité et de qualité de soins. C’est démobilisateur », lâche-t-il.

Enfin, il peste contre les 35 heures, pas respectées à l’hôpital. « Pour nous payer ce qu’ils nous doivent, ils ont inventé le compte épargne-temps (CET). Rien que pour l’ensemble des agents non médicaux, il y aurait 1,2 million de jours placés dessus. Martin Hirsch (directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris) devrait fermer l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris) pendant un an pour tous nous payer, les 35h on aimerait bien les connaître ». Selon lui, la gestion de l'hôpital public est devenue « une folie ». « Qu'ils s'en aillent tous [les dirigeants] », exhorte-t-il.