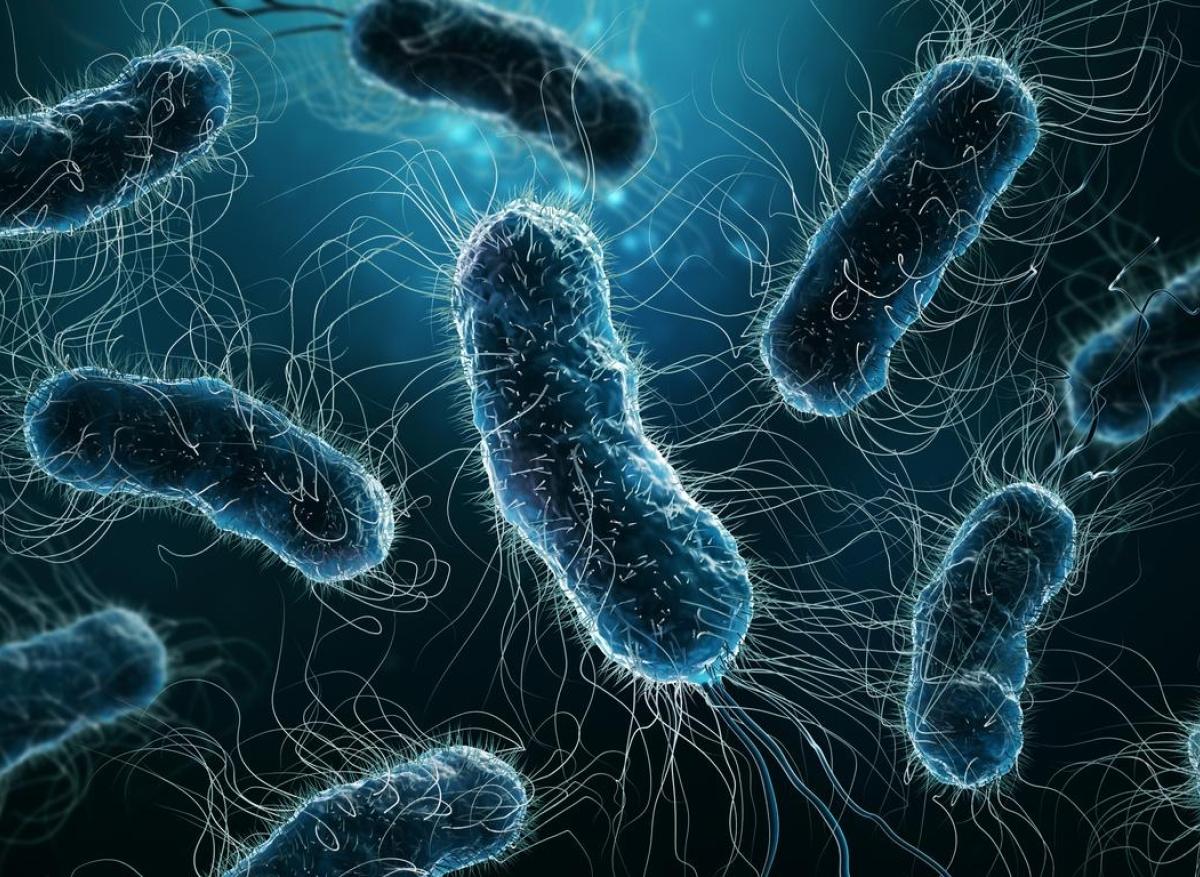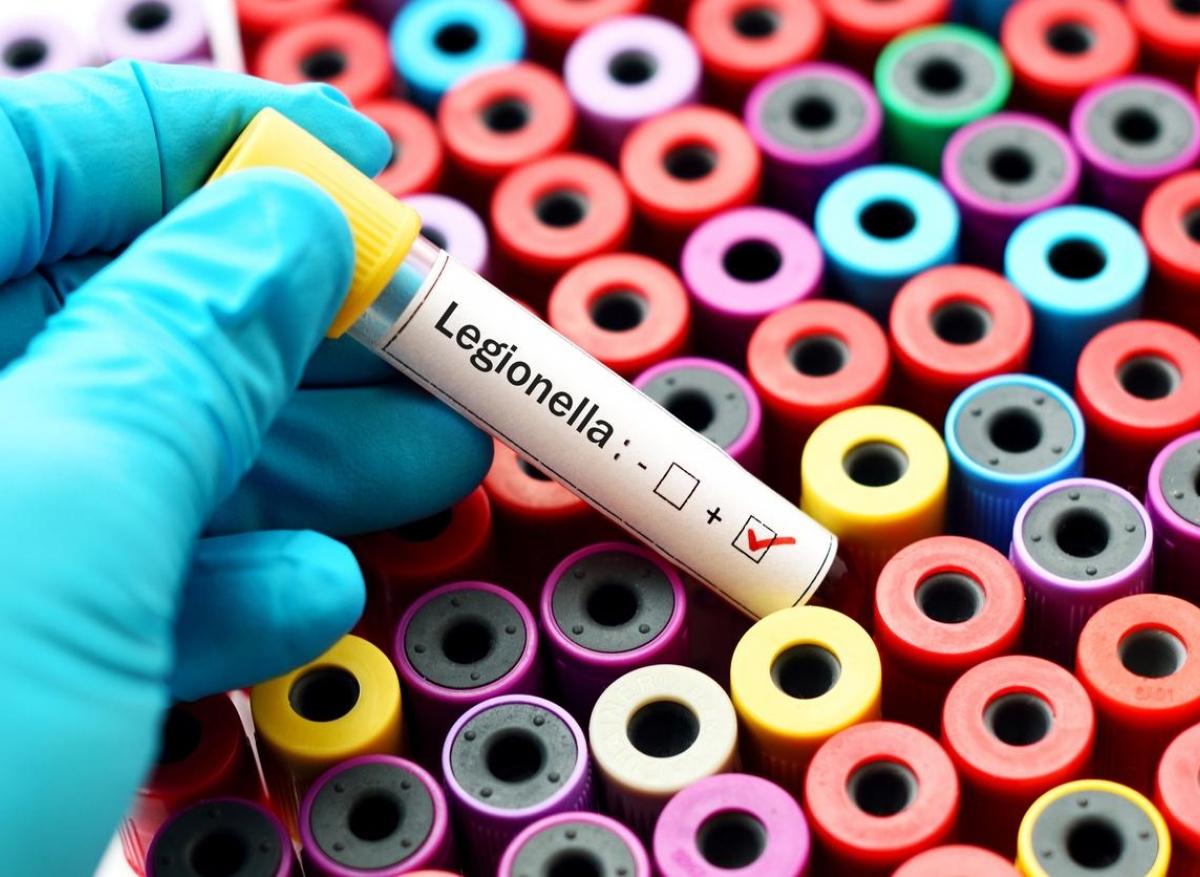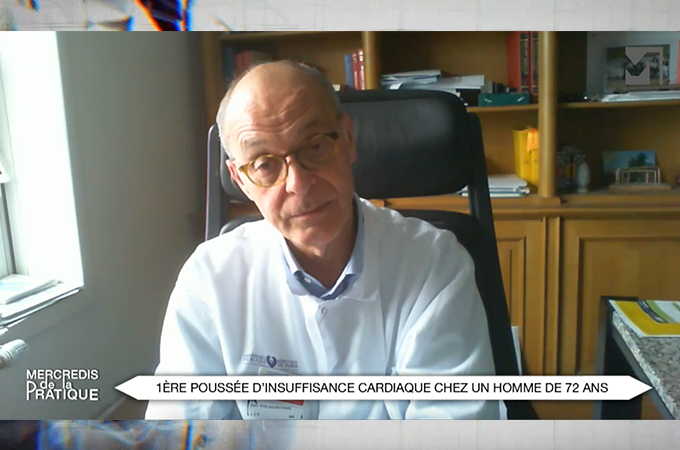Médecine générale
Légionellose : une présence possible dans les eaux stagnantes des lacs en été
La baignade dans les eaux stagnantes des lacs en été peut exposer à une légionellose, cause atypique de pneumonie. Une prise en compte de ce risque chez tout nageur en milieu naturel est donc importante à l’heure du réchauffement climatique, et pas seulement chez les personnes de plus de 50 ans, immunodéprimées ou comorbides.
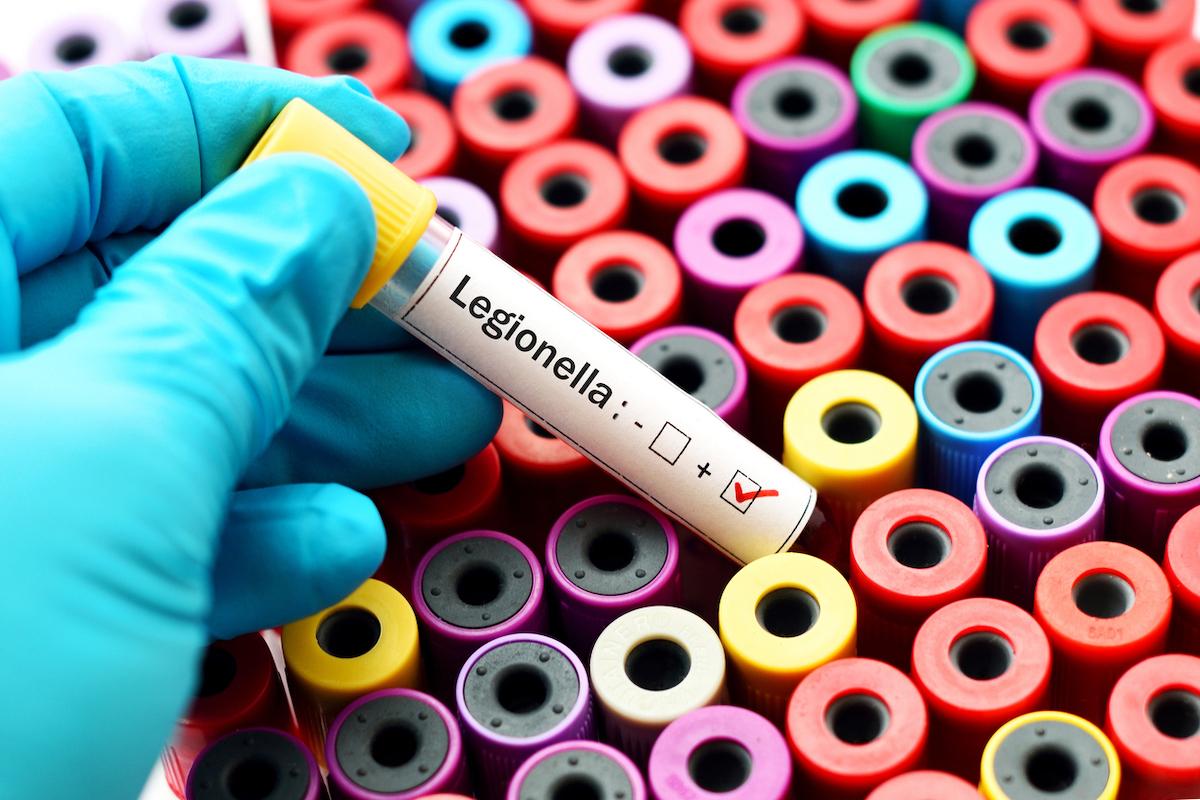
- jarun011/istock
Les infections liées à Legionella surviennent classiquement par inhalation de gouttelettes d’eau contaminée, issues de systèmes de climatisation, de fontaines ou de conduites mal entretenues. Mais cette bactérie peut aussi proliférer dans les eaux tièdes ou stagnantes, pouvant inclure certains lacs naturels.
C’est ce que nous rappelle un article paru dans le Canadian Medical Association Journal (CMAJ) sur le cas d’un homme de 77 ans atteint de légionellose deux semaines après avoir nagé dans un lac dans l’Iowa, aux États-Unis. Souffrant d’abord d’une fatigue croissante, de fièvre et d’une toux, il s’est finalement rendu à l’hôpital pour des chutes répétées à domicile. Les premiers traitements antibiotiques, sans couverture contre les germes atypiques, se sont avérés inefficaces.
À la faveur d’une reprise de l’anamnèse, et en prenant en compte un voyage récent et des bains dans un lac naturel de l’Iowa, les médecins ont suspecté une légionellose, qui a été confirmée par des analyses ciblées. Si moins de 100 cas de légionellose sont rapportés chaque année au Canada, il est probable que ce chiffre sous-estime la réalité, en raison de la difficulté diagnostique liée à cette pneumonie atypique. Les patients à risque incluent particulièrement les personnes âgées de plus de 50 ans, tabagiques, immunodéprimées, ou atteintes de comorbidités (cardiopathies, néphropathies, diabète).
La légionellose : une pneumonie atypique à ne pas oublier
La Legionella, bacille à Gram négatif aérobie, se développe dans des milieux humides chauds et stagnants, que ce soit des installations artificielles (systèmes de climatisation, jacuzzis, canalisations) ou des eaux naturelles (lacs, rivières). La légionellose se divise en deux entités : la « fièvre de Pontiac », forme bénigne et autolimitée, et la « maladie des légionnaires », qui se manifeste par une pneumonie bactérienne.
Sur le plan clinique, la légionellose peut débuter par un syndrome pseudo-grippal : fièvre, frissons, asthénie, éventuellement diarrhée, avant l’apparition de signes respiratoires (toux, dyspnée). Les facteurs de risque qui augmentent la probabilité d’une infection à Legionella incluent l’âge avancé, des antécédents de consommation de tabac, des maladies chroniques ou l’immunosuppression.
Les formes sévères requièrent une hospitalisation, et la réalisation de tests spécifiques, comme l’antigénurie urinaire ou la mise en culture de sécrétions pulmonaires recueillies par lavage bronchoalvéolaire, afin de confirmer le diagnostic et d’ajuster le traitement. L’antigénurie urinaire détecte essentiellement Legionella pneumophila sérogroupe 1, à l’origine de la majorité des cas, mais des variations géographiques existent.
Le traitement repose sur des antibiotiques actifs contre les germes atypiques. Les macrolides ou les fluoroquinolones respiratoires, associés éventuellement à des β-lactamines, sont recommandés en traitement empirique des pneumonies communautaires modérées à sévères. La mise en évidence d’une Legionella dans l’environnement justifie une investigation de santé publique pour prévenir les flambées épidémiques.
Réchauffement climatique, un changement des pratiques médicale
Chez les nageurs en eau libre, la légionellose doit être envisagée lorsqu’apparaît une pneumonie résistant aux antibiotiques à large spectre dépourvus d’activité sur les pathogènes atypiques. Les médecins sont donc incités à interroger leurs patients sur la notion d’une baignade en lacs ou rivières, en particulier si l’eau est tiède et peu renouvelée. Dans les situations à risque (malades immunodéprimés, voyages récents, épidémies localisées), il convient d’élargir rapidement la couverture antibiotique et de recourir à un diagnostic spécifique (antigénurie urinaire, culture de sécrétions).
Cette observation plaide donc pour une sensibilisation accrue des médecins et du grand public quant à la présence potentielle de Legionella dans les eaux stagnantes. Une prise en compte systématique de ce risque devrait conduire à des recommandations plus précises, notamment pour les personnes à haut risque de complications. Des études complémentaires pourraient mieux évaluer la prévalence exacte des infections liées aux baignades en eaux naturelles ainsi que l’évolution dans différents contextes géographiques et climatiques.