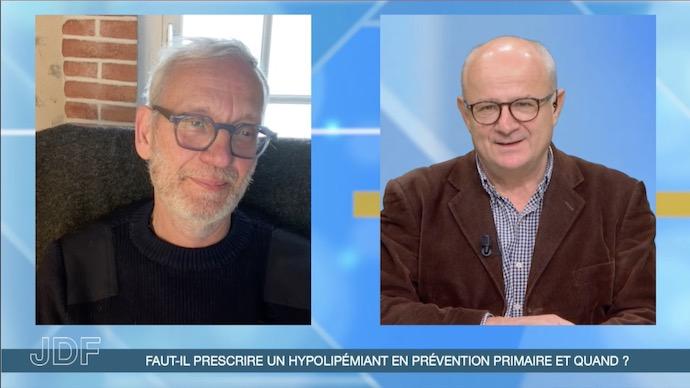Neurologie
Microplastiques : l’équivalent d’une cuillère de plastique dans le cerveau
Des échantillons de cerveau de personnes normales, prélevés lors d'une autopsie au début de l'année 2024, contiendraient 50% de minuscules morceaux de plastique en plus que huit ans auparavant. Chez des personnes normales, d’âge moyen de 45 ou 50 ans, les concentrations observées seraient sept à trente fois plus importantes que dans leurs reins et leur foie,

- Svetlozar Hristov/istock
Les plastiques présents dans l’environnement se fragmentent progressivement en microparticules (<5 mm) et nanoparticules (<1 µm). Compte tenu de l’essor considérable de la production de matières plastiques, l’exposition humaine s’accroît via l’ingestion (eau, aliments, emballages) et l’inhalation (particules en suspension dans l’air). Bien que des études antérieures aient déjà détecté ces micro- et nanoplastiques (MNPs) dans les poumons, le sang ou le placenta, les implications pour les tissus cérébraux demeuraient mal connues.
Une analyse récente, publiée dans Nature Medicine, et menée sur des échantillons cérébraux, hépatiques et rénaux provenant de personnes décédées (avec et sans pathologies neurologiques telles que la démence), révèle des concentrations de MNPs significativement plus élevées dans le cerveau que dans les autres organes. Les particules majoritairement retrouvées sont du polyéthylène, avec des teneurs cérébrales atteignant 4 800 µg par gramme de tissu dans certaines autopsies réalisées en 2024, soit environ 0,48 % du poids de la masse cérébrale.
Comparés aux prélèvements datés de 2016, ces taux sont en hausse de près de 50%. De plus, les cerveaux de patients atteints de démence présenteraient encore trois à cinq fois plus de fragments plastiques, déposés principalement au niveau des parois vasculaires et au sein des cellules immunitaires locales. Les auteurs soulignent cependant qu’il n’est pas possible, en l’état, de conclure à un rôle causal des nanoplastiques dans l’apparition de la démence ; ils mettent plutôt l’accent sur la vulnérabilité d’un cerveau déjà atteint par des mécanismes inflammatoires ou un dysfonctionnement de la barrière hémato-encéphalique.
Une contamination des cerveaux universelle et croissante
Cette enquête autopsique met en évidence plusieurs constats notables. D’abord, contrairement à ce que l’on pourrait attendre, l’âge, le sexe, l’ethnie ou la cause de décès ne semblent pas influencer de manière marquée le niveau de contamination plastiques, suggérant une exposition presque universelle. C’est essentiellement la période du décès qui fait la différence, avec une quantité plus élevée de fragments plastiques relevée chez les personnes décédées en 2024 qu’en 2016, en cohérence avec l’augmentation mondiale de la production et de l’utilisation de plastiques.
Ensuite, l’étude souligne que les concentrations de MNPs dans le foie et les reins, bien que moins élevées que dans le cerveau, laissent penser que certains mécanismes d’élimination partielle existent. Toutefois, la capacité réelle de « nettoyage » du système nerveux central, via ses voies de drainage spécifiques, demeure incertaine. Les données de tolérance clinique chez l’humain sont encore balbutiantes ; aucun lien de cause à effet n’a pu être prouvé entre présence cérébrale de MNPs et pathologies neurodégénératives ou inflammatoires. Néanmoins, l’hypothèse d’effets potentiels sur des voies cellulaires (stress oxydant, altération de la microcirculation, etc.) n’est pas exclue.
Une analyse combinée sur des prélèvement autopsiques à 8 ans d’intervalle
Sur le plan méthodologique, les chercheurs ont utilisé une approche combinée utilisant la pyrolyse GC-MS (gas chromatography–mass spectrometry) pour quantifier et identifier la nature chimique des fragments plastiques ; la spectroscopie infrarouge (FTIR, ATR) pour la caractérisation moléculaire en surface des échantillons et la microscopie électronique couplée à l’analyse EDS (energy-dispersive spectroscopy) afin de confirmer la présence de particules plastiques et d’observer leur morphologie (souvent en « éclats » de taille nanométrique).
Les échantillons provenaient de décès datés de 2016 ou 2024, ce qui permet une comparaison temporelle. De plus, quelques tissus cérébraux recueillis entre 1997 et 2013 ont servi de contrôle plus ancien. Bien que cette étude repose sur un nombre limité d’autopsies, le recours à plusieurs techniques analytiques renforce la robustesse des résultats. La représentativité clinique en population générale reste cependant restreinte et appelle à la prudence : des biais de sélection ou de conservation post mortem peuvent influer sur l’estimation quantitative.
Une prise de conscience pour la pratique médicale
Si la preuve d’une toxicité avérée chez l’humain fait encore défaut, ces observations plaident pour la prise de conscience de l’omniprésence des MNPs dans l’organisme, y compris au sein du système nerveux. Les médecins peuvent encourager leurs patients à limiter l’usage de plastiques à usage unique et à privilégier des modes de conservation alimentaire moins propices à la dissémination de microplastiques (p. ex., éviter le réchauffage au micro-ondes dans des contenants plastiques).
Par ailleurs, un suivi clinique attentif des patients avec des troubles neurodégénératifs pourrait comporter une évaluation, même expérimentale, de la contribution d’éléments environnementaux comme les nanoplastiques.
Au regard de l’essor continu de la production de plastique au niveau mondial, la mise en place de stratégies de prévention (réduction de la pollution plastique, meilleure gestion des déchets, alternatives moins toxiques) et de surveillance (recherche clinique et épidémiologique) paraît désormais indispensable pour protéger la santé publique et mieux cerner l’importance des micro- et nanoplastiques comme facteur de risque environnemental.






-1607941727.jpg)