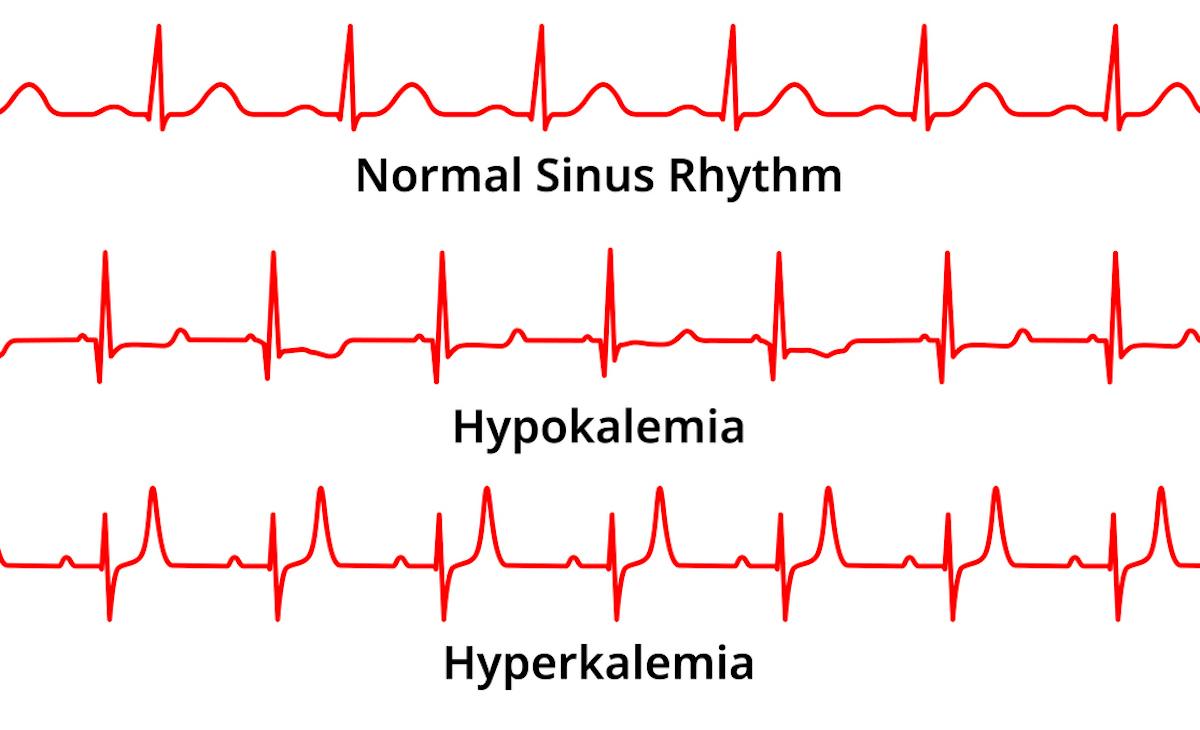Diabétologie
Diabète de type 2 : les bénéfices des nouveaux hypoglycémiants dépendraient de l’âge
Les inhibiteurs du SGLT2 et les agonistes du GLP-1 réduisent non seulement l’hyperglycémie mais également le risque d’événements cardiovasculaires, parfois indépendamment de la réduction glycémique. Cependant, l’efficacité de ces traitements pourrait varier chez les sujets âgés, souvent sous-représentés dans les essais cliniques.
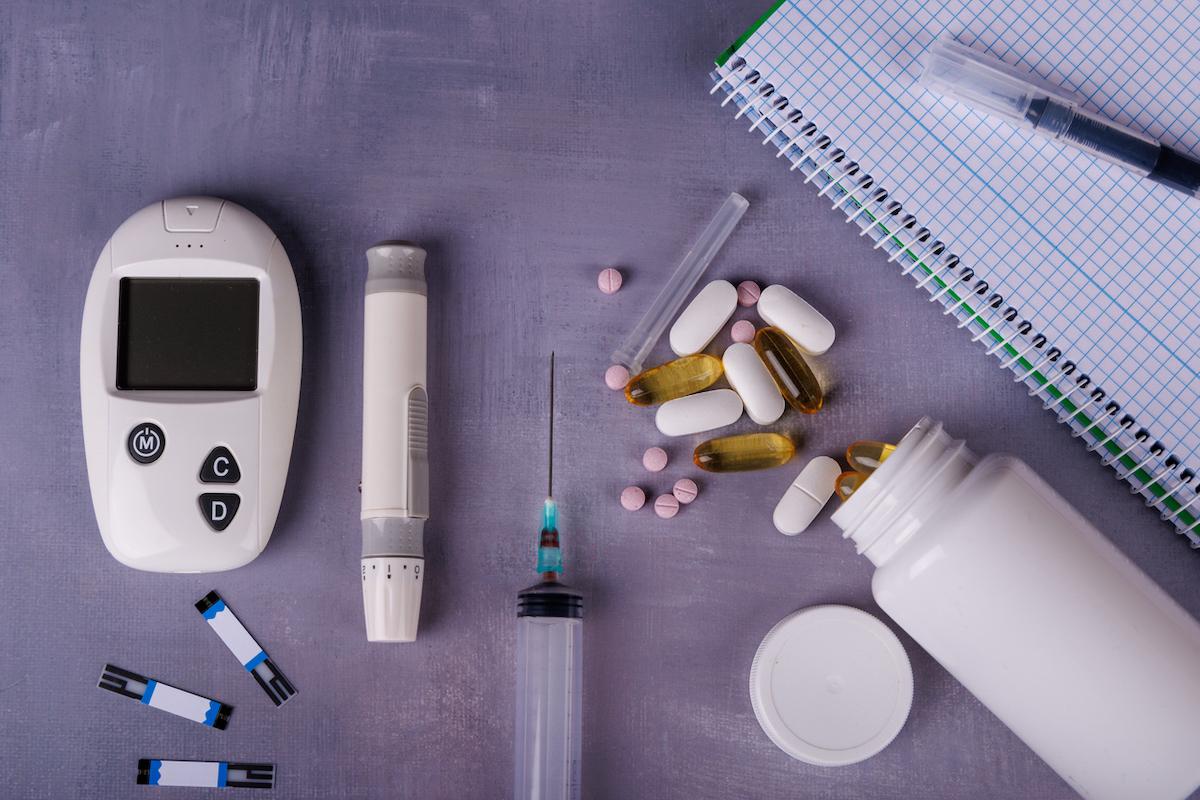
- Eduardo Monroy Husillos/istock
Au cours des deux dernières décennies, l’éventail des traitements du diabète de type 2 (DT2) s’est élargi avec l’arrivée des inhibiteurs du SGLT2, des agonistes du GLP-1 et des inhibiteurs de la DPP4. Ces classes ont montré un impact positif sur la réduction de l’HbA1c et la prévention des complications cardiovasculaires, en particulier les inhibiteurs du SGLT2 et les agonistes du GLP-1. Toutefois, les recommandations actuelles ne différencient pas formellement les options thérapeutiques selon l’âge ou le sexe, alors même que près de la moitié des patients atteints de DT2 ont plus de 65 ans et que les femmes, bien que moins à risque en valeur absolue, voient leur risque cardiovasculaire augmenter plus fortement que les hommes dès lors qu’elles développent un diabète.
Dans cette méta-analyse de 601 essais randomisés, publiée dans le JAMA, on observe chez les sujets âgés une moindre réduction de l’HbA1c avec les inhibiteurs du SGLT2 (par exemple, une perte d’efficacité allant jusqu’à +0,24 % pour la différence de réduction de l’HbA1c par tranche de 30 ans). En revanche, le même groupe de patients âgés bénéficie d’une protection cardiovasculaire renforcée, suggérant que l’impact cardioprotecteur des inhibiteurs du SGLT2 n’est pas simplement lié à la baisse de la glycémie. Les agonistes du GLP-1 montrent une tendance inverse, avec un meilleur contrôle de l’HbA1c chez les personnes plus âgées, mais un effet de réduction des événements cardiovasculaires plus marqué chez les plus jeunes. Par ailleurs, il n’a pas été mis en évidence de différence nette et significative entre hommes et femmes, que ce soit pour la baisse de l’HbA1c ou pour la diminution des événements cardiovasculaires majeurs (MACEs).
L’efficacité de ces traitements varie également selon le schéma thérapeutique
Au-delà de ce constat global, l’analyse des sous-groupes livre des informations plus précises. Premièrement, on remarque que l’efficacité de ces traitements varie également selon le schéma thérapeutique (monothérapie, bithérapie, trithérapie). Les inhibiteurs du SGLT2 semblent ainsi perdre légèrement en puissance hypoglycémiante chez les sujets âgés, avec une amplitude d’environ 0,17 à 0,25 % de différence supplémentaire d’HbA1c en comparaison du placebo, selon le nombre de traitements associés. En revanche, chez ces mêmes patients, l’effet protecteur sur les MACEs apparaît notablement supérieur, avec un hazard ratio à 0,76 par tranche de 30 ans.
Les agonistes du GLP-1, quant à eux, confirment leur efficacité glycémique plus marquée avec l’âge (jusqu’à –0,24 % supplémentaire d’HbA1c), même si leur effet cardioprotecteur semble mieux documenté chez les sujets plus jeunes, avec un hazard ratio à 1,47 pour l’interaction âge×traitement.
Du côté de la tolérance, on retrouve principalement les effets indésirables déjà connus : infections génitales pour les inhibiteurs du SGLT2 et troubles digestifs pour les agonistes du GLP-1, sans différence majeure liée à l’âge ou au sexe. Les inhibiteurs de la DPP4, enfin, occupent une place intermédiaire, avec une amélioration glycémique légèrement accrue chez les plus âgés, sans répercussion notable sur la prévention cardiovasculaire.
Une méta-analyse sur des essais incluant peu de personnes de plus de 80 ans
Les données analysées proviennent d’une revue systématique associant des résultats agrégés et, pour 17 % des essais (103), des données individuelles de patients, ce qui augmente la puissance statistique pour explorer les interactions âge×traitement et sexe×traitement. Les chercheurs ont utilisé un modèle de méta-régression en réseau pour comparer simultanément différentes classes médicamenteuses et différents schémas thérapeutiques, assurant une meilleure précision dans l’estimation des effets. Cependant, les essais cliniques impliqués incluaient peu de patients de plus de 80 ans ou en situation de fragilité avancée, ce qui limite la représentativité des résultats pour cette tranche d’âge très à risque.
Selon les auteurs, les données suggèrent néanmoins de privilégier, chez les sujets âgés, la prise en compte spécifique du bénéfice cardiovasculaire des inhibiteurs du SGLT2, et de ne pas se fier uniquement à la baisse de l’HbA1c. Les agonistes du GLP-1 restent pertinents chez les seniors pour l’équilibre glycémique et la réduction d’événements majeurs, bien que l’effet cardiovasculaire maximal semble surtout documenté chez les patients plus jeunes.
À l’avenir, il serait souhaitable de développer des essais ciblant spécifiquement les populations très âgées ou vivant avec une fragilité, afin de mieux caractériser l’équilibre entre les bénéfices (réduction des complications cardiovasculaires et rénales) et les risques (hypoglycémies, effets indésirables spécifiques). L’orientation des recommandations pourrait évoluer pour réaliser une analyse plus fine de l’état clinique (fonction rénale, vulnérabilité) et de l’âge fonctionnel plutôt que l’âge chronologique, notamment dans le choix d’une stratégie thérapeutique optimale pour les patients atteints de DT2.