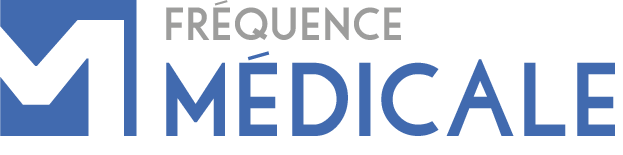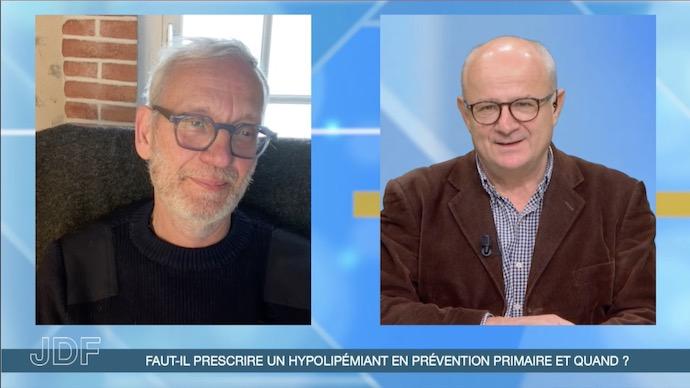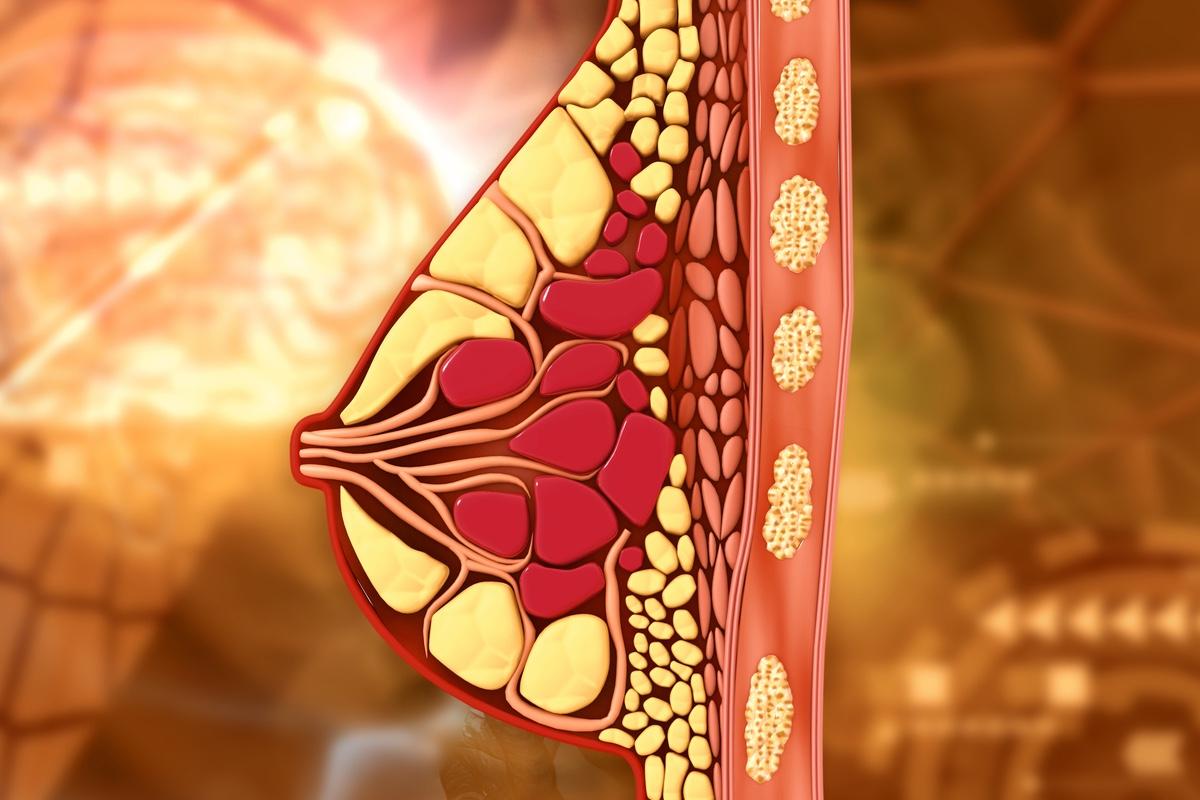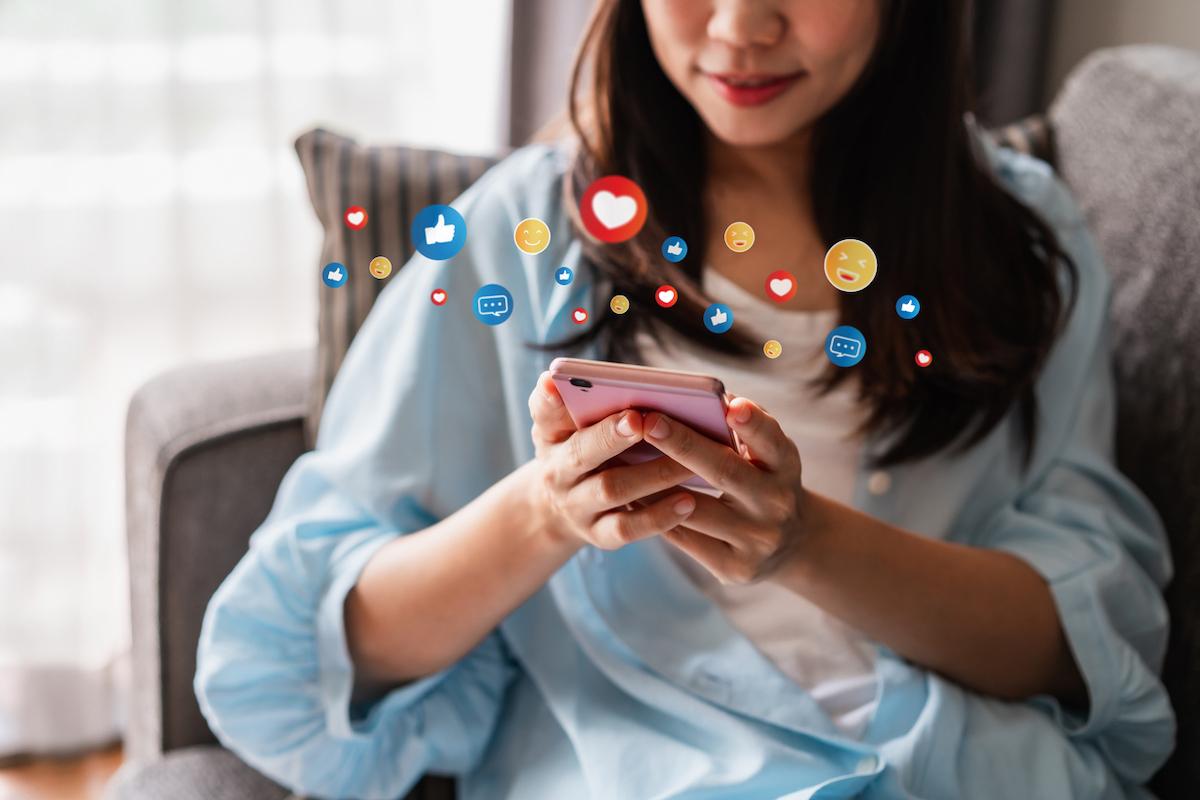Martine Baudin, directrice de Première Ligne
"Salles de shoot" : Genève a stoppé les contaminations par le VIH
ENTRETIEN – La salle de shoot de Genève a porté ses fruits. Après quinze ans d’existence, il n’y a plus de nouvelle contamination au VIH parmi les usagers de drogues injectables.

- Par Marion Guérin
- Commenting
- Le Quai 9, salle de consommation de Genève - Crédit : Première Ligne
En France, elles verront le jour à l’automne, dans la douleur et la polémique. Le projet d’ouverture de salles de consommation à moindre risque est sur les rails depuis plus de trois ans. Trois longues années de débats scientifiques, sociétaux, politiques, à évoquer les contextes locaux et les expériences étrangères – il en existe près d’une centaine à travers le monde.
Désormais bien documenté, le dispositif s’adresse aux usagers de drogues les plus précarisés. Injecteurs, crackers, toximanes, y consomment leurs produits (amenés par leurs soins) sous la supervision de professionnels médico-sociaux, avec un matériel propre et des conseils pour limiter les risques. Objectif : réduire les infections par le VIH/Sida et les hépatites, ainsi que la mortalité par surdose. Mais aussi ramener ces populations vers le système de soins et limiter les nuisances pour les habitants (seringues sur la voie publique, squats dans les halls d’immeuble…). A Paris, le 10e arrondissement a été choisi pour l’ouverture de la salle, qui déclenche de vives réactions malgré une efficacité avérée (voir reportage).
Chez nos voisins suisses, le dispositif a largement fait ses preuves. Martine Baudin dirige l’association Première Ligne, qui gère le Quai 9 – l’unique salle de consommation à moindre risque de Genève. Elle revient sur les difficultés rencontrées au moment de l’ouverture, les bénéfices constatés après quinze ans d’existence, et les moyens mis en œuvre pour rallier la population locale au projet.
Pourquoi Docteur : Au moment de l’implantation de la salle, en 2001, les riverains ont-ils manifesté des inquiétudes ?
Martine Baudin : Bien sûr, il est normal de voir des craintes s’exprimer. Je viens souvent à Paris lors des réunions de voisinage, et j’entends les mêmes choses qu’il y a quinze ans à Genève. Ces peurs sont légitimes, d’autant plus que le projet est encore virtuel et nourrit de nombreux fantasmes, alimentés par une méconnaissance du dispositif. Il faut écouter ces inquiétudes, ne pas les nier.
De fait, il s’agit d’une décision de santé publique : elle s’impose aux citoyens qui doivent faire avec. Ce n’est pas forcément facile à accepter. A l’époque, pour intégrer la population à ce projet, nous avons surtout travaillé sur du concret. En amont, il n’y a eu qu’une ou deux soirées d’information, mais un an après l’ouverture, nous avons mené plusieurs actions - ramassage de seringues, journal d’information, soirées voisinage.
Ces soirées ont eu lieu tous les deux mois, pendant plusieurs années. Elles réunissaient des riverains, des professionnels de l’addiction, des usagers de drogues. Chacune avait un thème : « les produits et leurs effets » ; « les traitements de substitution » etc. L’idée étant de travailler sur la connaissance et les représentations liées aux politiques de drogues et aux usagers. Il s’agissait aussi de lieux où les habitants pouvaient crier leur ras-le-bol ! Nous avons arrêté ces soirées car au bout d’un moment, les gens ne venaient plus, ils n’en ressentaient plus le besoin. Dans un sens, tant mieux.

Pdr : Est-ce que vous rencontrez les problèmes que craignent les habitants parisiens – attroupements, augmentation du trafic et de l’insécurité… ?
M.B : Globalement, il y a un climat très calme aux alentours de la salle, même si on rencontre parfois des problèmes, on ne peut pas le nier. De temps en temps, il y a une allée qui est investie pendant plusieurs jours par un ou deux usagers – il n’y a pas d’attroupements, en revanche. Nous répondons à toutes les sollicitations individuelles, nous nous déplaçons pour chaque demande et discutons avec toutes les parties. La police travaille aussi en étroite collaboration avec nous.
Concernant le trafic, il n’a pas augmenté aux abords de la salle. Nous avons tout de suite prévenu les usagers qu’il ne fallait surtout pas qu’ils viennent avec leurs dealers, qu’ils devaient se responsabiliser à ce niveau-là car l’impact serait trop négatif. Et ils nous ont écoutés. En revanche, nous avons un « trafic de fourmi », à savoir, des usagers qui vendent pour se payer leur consommation, et qui a toujours existé. Mais franchement, comment interdire la circulation de drogues au Quai 9 alors que nous ne parvenons pas à l'enrayer dans les prisons de haute sécurité ?
Nous avons toujours expliqué au voisinage que nous n’avions pas de baguette magique. Les habitants doivent pouvoir vivre dans un quartier correct, mais les personnes usagères ont aussi le droit d’utiliser l’espace public. C’est un compromis à trouver.

Pdr : La salle de consommation a-t-elle eu les effets sanitaires espérés ?
M.B : C’est indubitable : le dispositif a permis de faire chuter la transmission du VIH/Sida parmi la population consommatrice de drogues par voie intraveineuse. En Suisse, nous étions à plus 70 % de VIH parmi les injecteurs en 1991. Grâce à tout l’arsenal de mesures de réduction des risques, nous sommes passés à moins de 10 % au début des années 2000. Aujourd’hui, à Genève, il n’y a plus de VIH au sein de cette population.
Les bénéfices ont également été constatés sur la mortalité par overdose, qui a réellement diminué, puisque tout l’intérêt des salles de consommation consiste à travailler sur les pratiques. Nous apprenons aux injecteurs à utiliser correctement une seringue, de manière plus précise et personnalisée que ne le font les associations en dehors du contexte des salles. Nous leur fournissons des conseils pour limiter les risques : ne jamais consommer seul, ne pas mettre tout le dosage en une seule fois… Nous ne contrôlons pas la qualité des produits, mais nous pouvons conseiller de changer de fournisseur. Les usagers ont également été formés à la réanimation, aux premiers gestes qui sauvent.