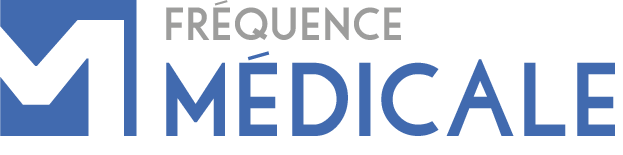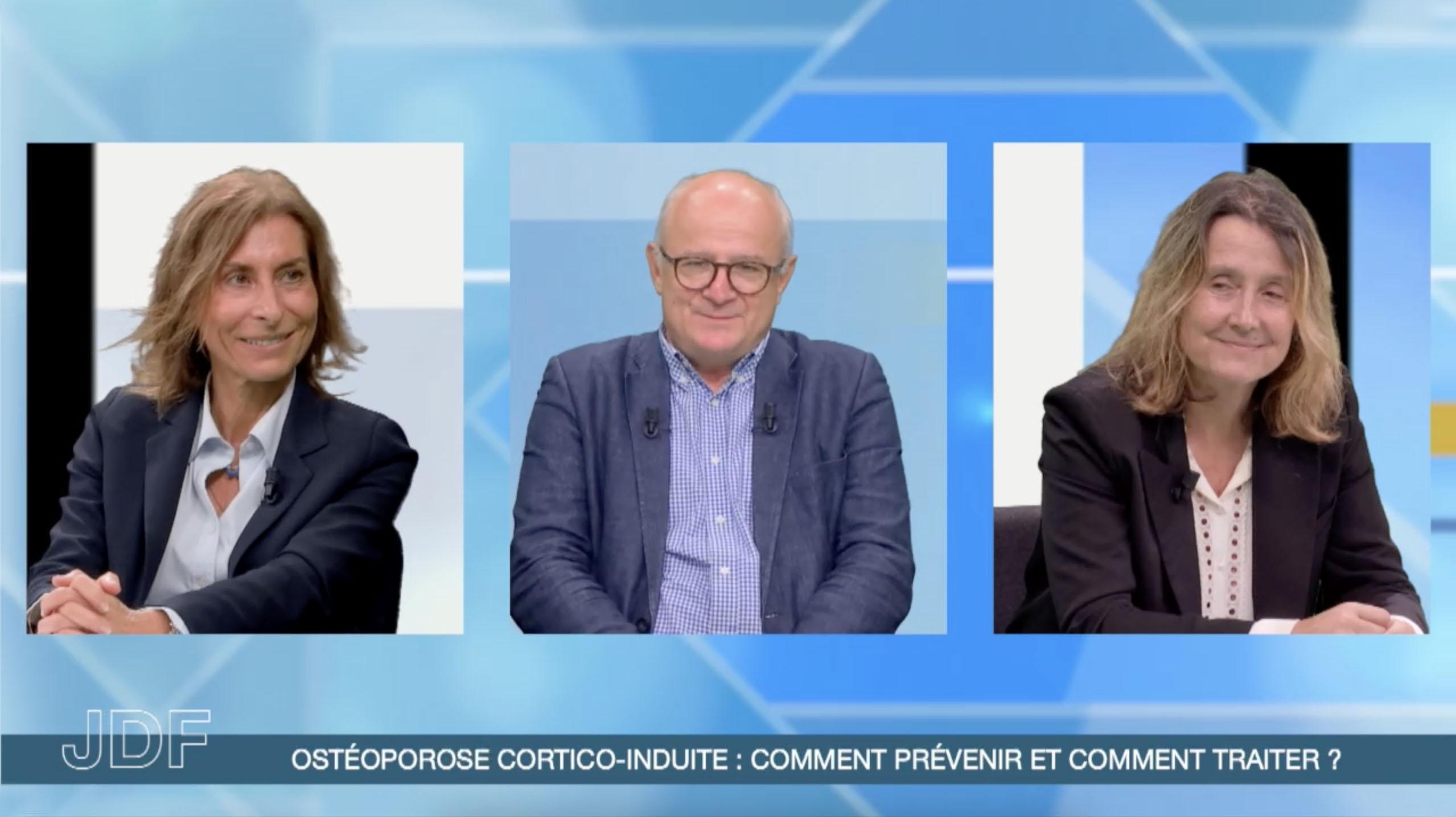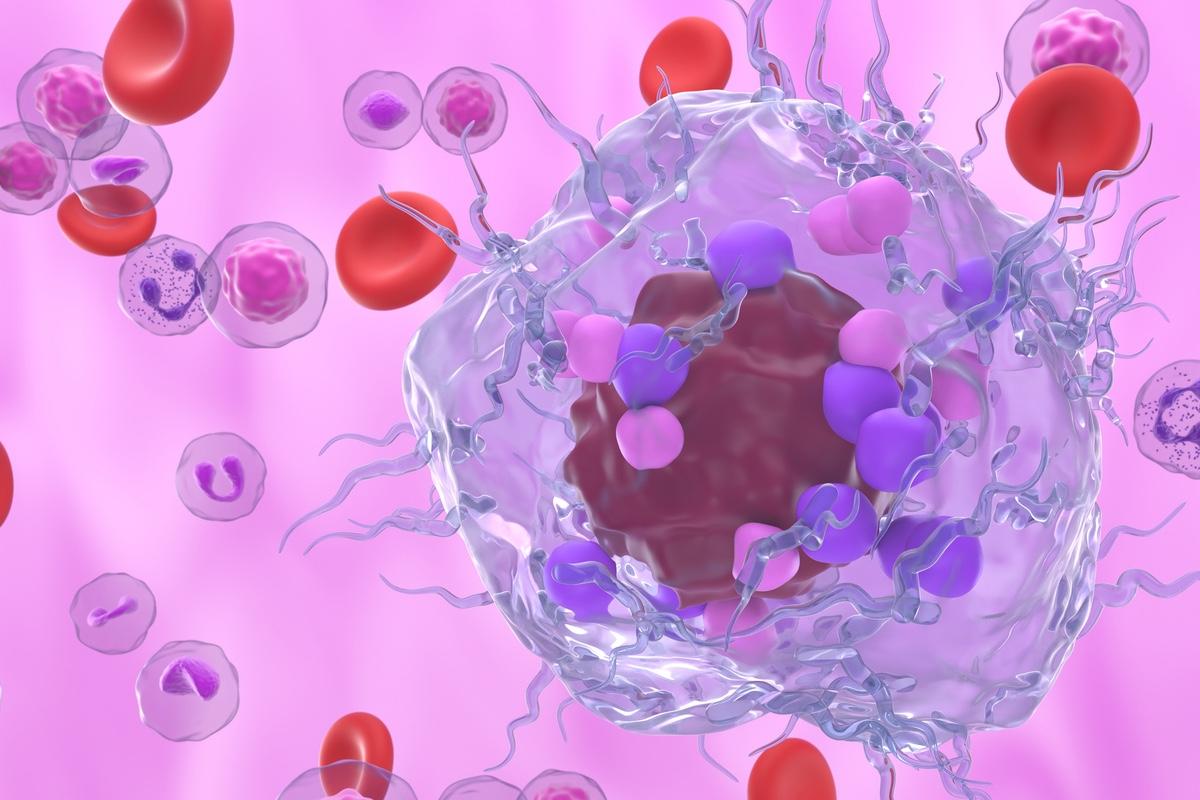L'interview du week-end
"Lutter contre l’obésité maintenant, c’est aussi prévenir toutes les maladies qui y sont associées"
Anne-Sophie Joly, co-autrice de "Je n'ai pas choisi d’être gros.se", nous raconte son combat pour changer le regard de la société sur l’obésité, une maladie largement stigmatisée qui n’est toujours pas reconnue à part entière.

Fondatrice et présidente du Collectif national des associations d’obèses (CNAO), Anne-Sophie Joly est co-autrice, avec le journaliste Richard Zarzavatdjian, du livre-manifeste Je n'ai pas choisi d’être gros.se (2024, éd. Solar).
Pourquoi Docteur : Comment en êtes-vous arrivée à fonder le CNAO et écrire sur le sujet de l’obésité ?
Anne-Sophie Joly : Je souffre de surpoids depuis longtemps, donc je suis avant tout une patiente. Quand j’ai voulu obtenir des informations pour me soigner, je n’ai rien trouvé. Les médecins conseillaient simplement d’arrêter de manger et de courir, au risque sinon d’avoir des problèmes cardiométaboliques et d’articulations. Mais la restriction alimentaire est difficile à tenir dans la durée : même la Haute autorité de santé (HAS) estime qu’au-delà de six mois restrictifs, le corps lâche. Lorsque je suis entrée dans un parcours de soins à la fin des années 1990, je me suis rendu compte qu’il fallait aller plus loin : cadrer l’obésité, protéger les patients, former les professionnels de santé... Le collectif est né au mois de mars 2003, avec l’ambition d’aider et d’informer.
Notre livre est à destination du grand public. Nous abordons des sujets comme les obstacles pour trouver du travail lorsqu’on est obèse, les difficultés pour s’habiller ou se déplacer, les freins à l’embauche, la stigmatisation... Je n’ai pas écrit 1 % de ce qu’on a pu vivre comme discriminations liées au poids, car je ne voulais pas que ce soit un livre de haine ou de rancœur. Mais je veux que les gens qui méconnaissent ou sous-estiment l’obésité aient la curiosité, peut-être, d’écouter ce que nous avons à dire.
Les causes de l’obésité sont génétiques mais aussi environnementales : l’alimentation ultra-transformée, la sédentarité, les perturbateurs endocriniens, les traumatismes, le milieu social dans lequel on évolue...
"On ne décide pas d'être gros." Pouvez-vous rappeler en quoi l'obésité n'est pas un choix mais bien une maladie multifactorielle ?
Les raisons pour lesquelles on prend du poids sont en effet plurielles. Il y a d’abord la cause génétique : un enfant dont l’un des parents souffre de surpoids ou d’obésité a un risque accru de 40 % de déclencher le surpoids ou l’obésité, et de 80 % si les deux parents en souffrent. De même, si la mère a développé un diabète gestationnel ou si l’enfant n’a pas été allaité, cela augmente encore les risques. Pareil si l’enfant est né par césarienne et non par voie basse : le bébé souffre d’une carence en termes d’insémination microbienne car il n’a pas été ensemencé, au passage, par certaines bactéries du microbiote vaginal. Plus tard dans la vie, un adulte atteint de surpoids ou d’obésité a deux fois moins de microbiote intestinal qu’une personne de stature normale, et son peu de microbiote est deux fois moins efficace. C’est-à-dire que biologiquement parlant, il ne part déjà pas sur un pied d’égalité.
D’autres causes, environnementales, s’ajoutent à la génétique : l’alimentation ultra-transformée, faite de gras, de sel et de sucre ; la sédentarité (95 % de la population est sédentaire et ne fait pas assez d’activité physique) ; les perturbateurs endocriniens ; les traumatismes physiques et psychologiques ; et pour finir, le milieu social dans lequel on évolue, c’est-à-dire les habitudes de consommation, le manque d’offre alimentaire autour de chez soi (les fast-foods sont partout), bref la société en général.
Pour résumer, il y a une prédisposition génétique et des facteurs environnementaux, qui vont soit compenser soit aggraver la chose. Avec mon fils, par exemple, mon mari et moi-même sommes très vigilants sur le plan alimentaire : nous n’interdisons rien, pour éviter la psychose, mais nous surveillons la quantité des aliments transformés, des sodas, des sucreries... Le problème, c’est l’excès. C’est également une affaire de transmission culturelle : mon fils m’accompagne au marché deux fois par semaine et depuis ses 2 ans, il écosse les petits pois !
Toujours plus sucrée, plus salée, moins qualitative... La nourriture devient un anti-dépresseur, et à terme, une addiction – qui est aussi une maladie [...] On sort donc de l’alimentation mécanique, nutritive, de besoin.
En quoi est-ce trop simpliste de dire "Faites un régime" ou "Allez courir" ?
Parce que l’injonction ne suffit pas ! Il y a une offre alimentaire ultra-transformée, toujours plus sucrée, plus salée, moins qualitative et plus addictive, qui explose depuis des décennies et qui nous pousse à consommer toujours davantage. C’est quand même cela, l’objectif de l’industrie : consommer. Pour fonctionner au niveau métabolique, notre corps a besoin de protéines, de glucides, de fibres... Mais à côté de cela, il y a les denrées non nécessaires, qui "font plaisir", qu’on a tendance à consommer après avoir passé une mauvaise journée ou lorsqu’on est angoissé à l’idée de ne pas pouvoir payer ses factures : la nourriture devient un anti-dépresseur, et à terme, une addiction – qui est aussi une maladie. Il ne faut pas non plus oublier que cela dépend de l’image qu’on a de l’alimentation, de par son histoire, ses racines, son éducation : beaucoup de parents voient comme une preuve d’amour le fait de donner à leurs enfants des produits qui "font plaisir". On sort donc de l’alimentation mécanique, nutritive, de besoin. Il est nécessaire d’accompagner les gens en leur disant de se faire plaisir, certes, mais de calculer leur plaisir : mieux vaut cuisiner son propre gâteau qu’en acheter un industriel, par exemple.
Les personnes en surpoids ou obèses sont considérées comme des gens décérébrés, incultes, fainéants. Elles sont même l’incarnation d’un des sept péchés capitaux.
Quelles sont les discriminations auxquelles sont confrontées les personnes obèses ?
Je donne quelques exemples dans notre livre. Lors d’un déplacement en Guadeloupe pour un congrès, j’ai rencontré un enfant de 11 ans et 115 kg, qui souffre de grossophobie et de stigmatisation depuis qu’il a l’âge de 6 ans. Non seulement il se fait harceler par ses camarades, mais il est aussi très mal perçu par la directrice de l’établissement. Certains professeurs lui disent "C’est ta faute, tu n’as qu’à maigrir", d’autres lui conseillent même de quitter l’école et de rester chez lui. L’enfant m’a soufflé dans l’oreille qu’il envisageait de se suicider depuis des années.
Cette grossophobie, je la constate fréquemment, voire je la vis moi-même. L’été dernier, sur un marché en Bretagne, j’étais dans la queue d’un traiteur-charcutier. Devant moi, un couple de retraités demande au commerçant un morceau de lard "mais, pitié, pas aussi gras que vous" – et vu la manière dont c’était dit, il n’y avait pas une once d’humour. Je les interpelle alors en leur disant : "Je ne sais pas si vous avez conscience de l’insulte que vous venez de proférer à ce pauvre monsieur." L’homme se retourne et me répond : "Et vous, la grosse vache, on ne vous a rien demandé." On ne peut pas ainsi insulter les gens et laisser croire que c’est la norme... J’ai réagi vivement, le ton est monté, tout le monde s’est arrêté dans le marché. Autre exemple, il y a dix jours, j’assiste à une réunion officielle, sous instance étatique. Je suis assise à ma place et, derrière moi, j’entends une femme – menue – arriver dans mon dos et dire "Ah bah je ne vais pas avoir beaucoup de place...".
Ce genre de situations, c’est du quotidien. La grossophobie, la stigmatisation envers les personnes obèses est l’une des choses les plus répandues et les plus tolérées dans le monde. Les gens ont peur de ce qu’ils ne connaissent pas et ont besoin de se sentir supérieur à leur environnement ou comme faisant partie de la "norme" (selon leurs critères). Et dès l’instant où vous sortez de leurs repères, vous êtes dénigré. Les personnes en surpoids ou obèses sont considérées comme des gens décérébrés, incultes, fainéants. Elles sont même l’incarnation d’un des sept péchés capitaux.
Les petites phrases assassines des médecins sont tellement insupportables que 30 % des personnes obèses mettent en danger leur santé : pas de dépistage, pas de visite chez le gynécologue, ni chez le dentiste...
Encore plus grave, peut-être, c’est la stigmatisation par le milieu médical, censé être du côté des malades et donc du soin, de la survie...
Sur les dix millions de personnes qui souffrent d’obésité en France, 30 % n’osent plus se rendre chez le médecin, de peur d’être discriminées. Moi-même, lorsque j’étais enceinte à l’hôpital, j’ai entendu des soignants passer devant ma chambre et dire à voix haute, suffisamment fort pour que j’entende : "Elle est folle, celle-là, elle est grosse et elle fait un bébé ?" Les petites phrases assassines de la part du corps médical sont tellement insupportables à entendre que certains en viennent donc à mettre en danger leur santé : pas de dépistage, pas de visite chez le gynécologue, ni chez le dentiste... Il faut rappeler que l’obésité est la quatrième cause de mortalité dans le monde, et qu’elle est mère de dix-huit pathologies associées : les personnes obèses ont, par exemple, entre 4 et 8 fois plus de risque de développer un cancer. Pendant la pandémie de Covid, 40 % des patients décédés et 45 % des patients en réanimation étaient des gens en surpoids ou obèses, qu’importent l’âge et les antécédents de santé. Il a fallu que je me batte pour obtenir de l’Etat que les personnes obèses soient vaccinées en priorité contre le Covid, au même titre que les populations âgées, atteintes de comorbidités, immunodéprimées, etc.
Malgré son augmentation, l’obésité n’est toujours pas reconnue comme une maladie à part entière. Quels sont les freins à cette reconnaissance ?
Pendant longtemps, il n’y avait pas de médicament, de molécule spécifique contre l’obésité, et pour la plupart des gens, s’il n’y a pas de médicament, il n’y a pas de maladie. Cela a tendance à changer : le Wegovy, qui aide les personnes obèses à perdre du poids, est actuellement en essai clinique sur 10.000 patients, et de nombreux laboratoires travaillent sur des analogues du GLP-1, initialement utilisé pour traiter le diabète de type 2. S’ouvre donc un champ thérapeutique qui n’existait pas avant, ce qui est encourageant. Mais il existe un autre frein, plus politique : si l’on reconnaît l’obésité comme une maladie chronique, le nombre d’affections longue durée (ALD) va exploser, ce qui va coûter de l’argent. Les pouvoirs publics sont donc frileux. Mais si l’on ne fait rien, cela coûtera encore plus cher dans quelques décennies ! Prendre en charge l’obésité maintenant, c’est non seulement traiter l’aggravation de la santé des personnes obèses, mais c’est également prévenir toutes les maladies associées à l’obésité... Lutter contre le surpoids est un investissement sur l’avenir.
L’urgence concerne avant tout les enfants : comment faire en sorte qu’ils ne deviennent pas ce que nous sommes aujourd’hui ? [...] Bien manger, c’est s’armer contre les pathologies futures.
Quelles pistes de solutions envisagez-vous contre l'épidémie d’obésité et contre la grossophobie ?
Il est urgent d’arrêter les "mesurettes". Il faudrait, comme pour le cancer, lancer un plan interministériel (Transports, Agriculture, Education nationale, Finances...) sur dix ans renouvelables, et investir dans la recherche, qu’elle soit purement médicale ou sociétale.
On doit former davantage les professionnels de santé et les métiers qui sont au contact des enfants, de la crèche à la sortie d’université. Le cantinier de l’école, par exemple : des pâtes cuites pendant deux heures, ce ne sont plus des pâtes mais du sucre ! Il est nécessaire de faire participer les sociétés savantes médicales, les associations de patients, mais également l’agroalimentaire, l’Union des marques, les annonceurs, les régulateurs de la publicité... On a besoin de tout le monde, il n’y a pas de petite action. Tout l’enjeu est de légiférer : le Nutri-Score est un bon début mais il n’est pas obligatoire, donc comment peut-on obliger l’agroalimentaire à améliorer la qualité de la transformation des aliments ?
L’urgence concerne avant tout les enfants : comment faire en sorte qu’ils ne deviennent pas ce que nous sommes aujourd’hui ? L’activité physique doit notamment être davantage promue. Le CNAO s’est battu, lors de la dernière élection présidentielle, pour que les programmes scolaires incluent 30 minutes d’activité physique quotidienne [en plus des cours d’EPS]. Protéger les jeunes, c’est aussi tenter de bloquer les publicités mensongères sur les réseaux sociaux et les influenceurs qui propagent la haine contre les personnes en surpoids. Lutter contre l’obésité doit passer par la pédagogie : il faut informer les consommateurs sur ce qu’ils mangent réellement. Moi, lorsque j’ai commencé à prendre du poids, j’aurais aimé savoir. Or, si les gens sont aujourd’hui mieux informés de la transformation des aliments ou des dangers du sucre, c’est uniquement grâce aux lanceurs d’alerte, aux associations, aux médias, pas aux industriels. Il est nécessaire, enfin, que les gens sachent pourquoi il est crucial de manger sainement : cela booste, via le microbiote, les défenses immunitaires qui vont repousser l’apparition de maladies chroniques (cardiovasculaires, cancers, diabète...), mais aussi de maladies neurodégénératives et psychiatriques. Bien manger, c’est-à-dire bannir les produits toxiques et favoriser les aliments sains, c’est s’armer contre les pathologies futures.
Considérez-vous qu’une personne obèse doit s’accepter, malgré le fait que sa maladie peut lui causer de nombreux problèmes de santé, ou doit-elle avoir l’intention de perdre du poids pour se préserver ?
Je crois que les gens font ce qu’ils peuvent avec ce qu’ils ont, au moment où ils y sont. Chacun a son histoire, sa temporalité, ses blessures, son entourage... Je ne porte pas de jugement. Dire "Il n’y a qu’à" et "Faut que" ne sert rien. Simplement, le jour où la personne voudra y faire quelque chose et être aidée, il faut qu’elle puisse trouver des conseils au bon endroit, et c’est le rôle des collectifs comme le nôtre.