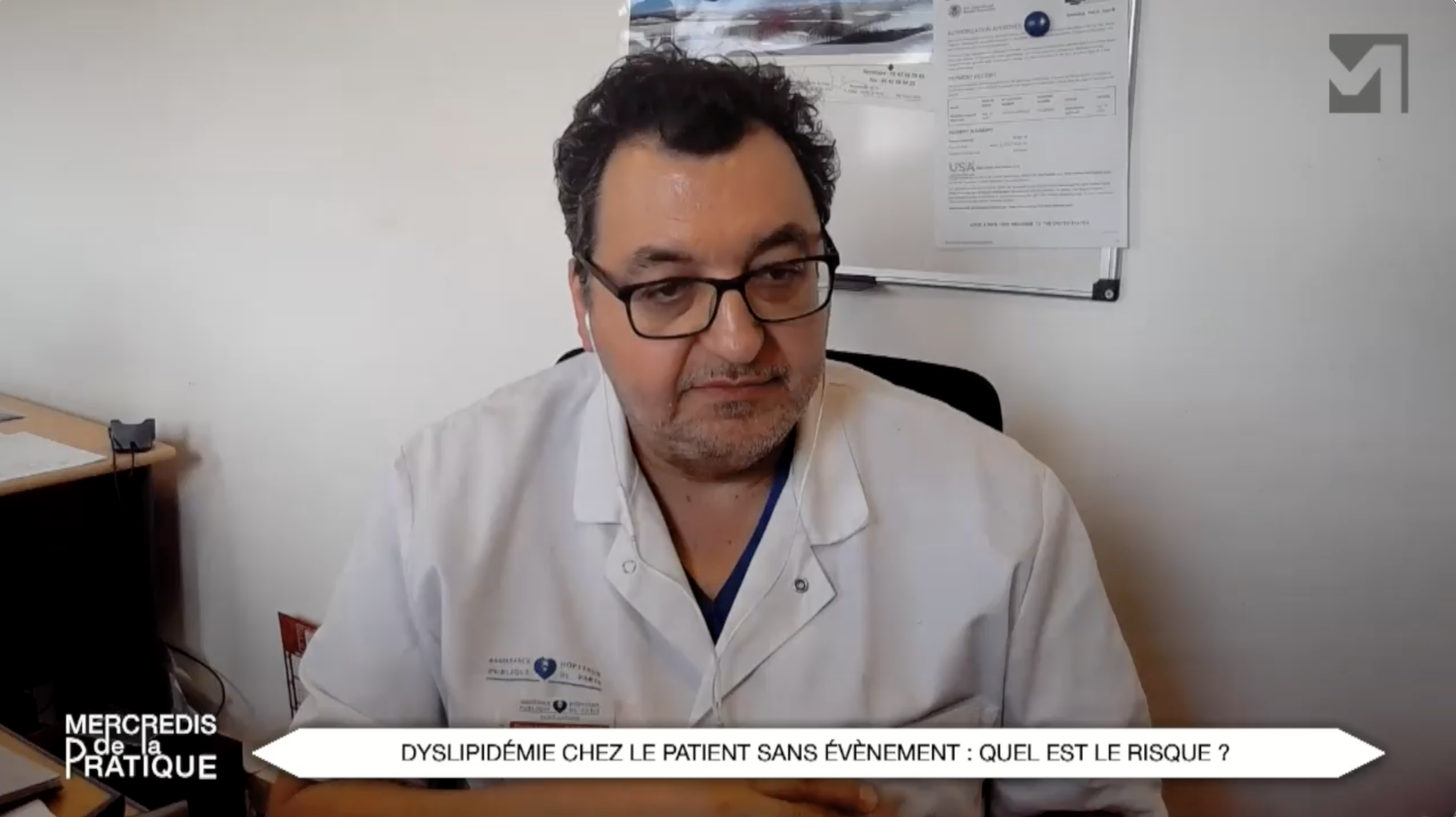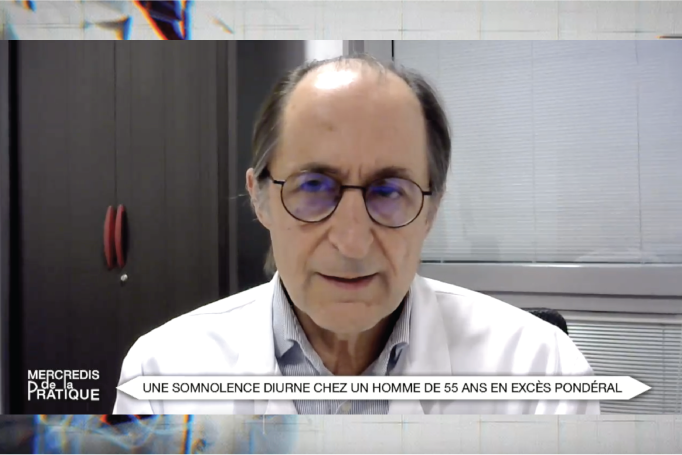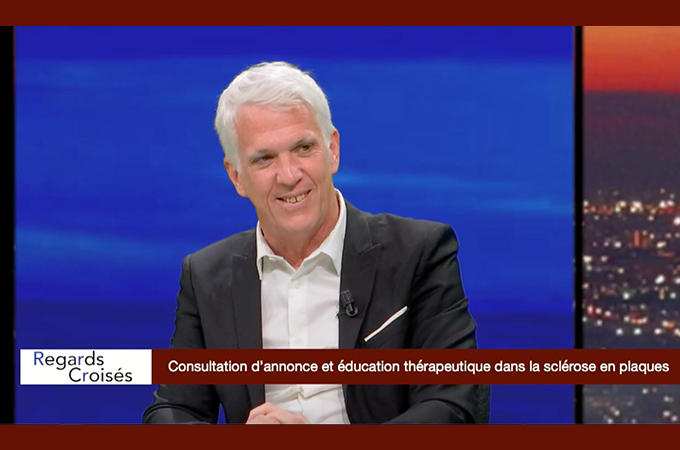Cardiologie
Arrêt cardiaque : toujours une cause sous-jacente même chez les jeunes en bonne santé apparente
Les arrêts cardiaques chez les jeunes adultes sont relativement fréquents. Leur apparente bonne santé est en effet trompeuse : ils sont généralement porteurs de facteurs de risque cardiovasculaire ou de pathologies sous-jacentes. Une étude américaine nous en dit un peu plus.

- johan63/iStock
L'incidence des arrêts cardiaques extrahospitaliers chez les adultes de moins de 40 ans apparemment en bonne santé est comprise entre 4 et 14 pour 100 000 personnes-années dans le monde.
Sur les 350 000 à 450 000 arrêts cardiaques extrahospitaliers estimés chaque année aux États-Unis, environ 10 % survivent. Deux chercheurs américains se sont penchés sur la question, permettant ainsi d’expliquer cette situation alarmante.
Une revue d’études à partir d’autopsies
Cette revue de plusieurs études publiée dans JAMA a fait suite à une constatation du Pr Zian H. Tsengen, auteur principal, transmise lors d’une interview sur AMA Ed Hub (JAMA Network) : « Traditionnellement, on considère que les personnes réanimées après un arrêt cardiaque et hospitalisées ou les survivants d'un arrêt cardiaque ultime sont les mêmes que ceux qui sont décédés en dehors de l'hôpital ou au service des urgences, et on présume qu'il s'agit de morts subites d'origine cardiaque. Il s'avère que ces conditions ne sont pas tout à fait les mêmes. Les patients en réanimation et en arrêt cardiaque sont généralement examinés par des cliniciens à l'hôpital. En revanche, les décès survenus en dehors de l'hôpital relèvent généralement de la compétence d’autres médecins, et ces cas ne font pas l'objet d'une enquête systématique. »
Les chercheurs se sont donc basés sur quelques études systématiques effectuées à partir d’autopsies.
Seulement 9 à 16 % de survivants lors d’arrêt cardiaque extrahospitaliers
Selon eux, les arrêts cardiaques du sujet jeune, c’est-à-dire de moins de 40 ans, peuvent être dus à une maladie cardiaque héréditaire ou acquise ou à des causes non cardiaques. Parmi ces jeunes, seuls 9 à 16 % survivent jusqu'à la sortie de l'hôpital. Les chercheurs ont observé qu’environ 60 % mouraient avant d’arriver à l’hôpital, considérant alors qu’il s’agissait d’une mort cardiaque subite dite présumée, 40 % survivait jusqu’à l’hospitalisation (arrêt cardiaque subit réanimé) et qu’entre 9 et 16 % survivent jusqu’à la sortie d’hospitalisation (survivant d’arrêt cardiaque subit). Parmi ces derniers, environ 90 % ont un bon état neurologique avec une échelle de performance cérébrale 1 ou 2.
Ces études à partir d’autopsies montrent que 55 à 69 % des jeunes adultes décédés de mort cardiaque subite présumée avaient une pathologies cardiaques sous-jacentes comme une arythmie (cœur normal à l’autopsie, surtout chez les athlètes) ou une cardiopathie structurelles (coronaropathie pour ¼ des cas…). Les maladies non cardiaques responsables d’arrêt cardiaque en dehors de l’hôpital sont entre autres une surdose de médicaments, une embolie pulmonaire, une hémorragie sous-arachnoïdienne, une crise d'épilepsie, une anaphylaxie ou une infection. Plus de la moitié des jeunes adultes concernés par un arrêt cardiaque présentaient des facteurs de risque cardiovasculaire (HTA, diabète). Une maladie cardiaque génétique, telle que le syndrome du QT long, Wolff-Parkinson-White ou une cardiomyopathie hypertrophique ou dilatée, est détectée chez 2 à 22 % des jeunes adultes ayant survécu à un arrêt cardiaque, soit un taux plus faible que chez les non-survivants (13 à 34 %) dont la mort cardiaque subite a été confirmée par l'autopsie.
Une évaluation clinique à ne pas négliger…
Selon les scientifiques, les personnes réanimées à la suite d'un arrêt cardiaque soudain doivent faire l'objet d'une évaluation avec un profil métabolique de base et une troponine sérique, un test toxicologique urinaire, un électrocardiogramme, une radiographie thoracique, une tomodensitométrie de la tête au bassin et une échographie au chevet du patient afin de détecter une tamponnade péricardique, une dissection aortique ou une hémorragie. Les causes sous-jacentes réversibles, telles qu'un infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST, une anomalie coronarienne et une surdose de drogues illicites ou de médicaments (y compris les médicaments allongeant l'intervalle QT) doivent être traitées.
Si l'évaluation initiale ne révèle pas la cause de cet arrêt cardiaque extrahospitalier, une échocardiographie transthoracique doit être effectuée pour dépister une cardiopathie structurelle (par exemple, une cardiomyopathie insoupçonnée) ou une maladie valvulaire (par exemple, un prolapsus de la valvule mitrale). L’implantation d'un défibrillateur est indiquée pour les jeunes adultes ayant survécu à un arrêt cardiaque soudain et présentant des causes cardiaques non réversibles, notamment une cardiopathie structurelle et une arythmie.
…sans oublier le côté psychologique
Grâce à cette étude, l’équipe scientifique confirme qu’il est indispensable de rechercher une cause à tout arrêt cardiaque, que celle-ci soit génétique, structurelle, fonctionnelle, arythmique, médicamenteuse ou toxique.
En effet, le Pr Tseng souligne, lors de l’interview accordée à JAMA Network (podcast), que ces arrêts cardiaques sont des « événements catastrophiques qui ont des effets négatifs considérables sur les patients et les membres de leur famille. Il est donc important de procéder à une évaluation psychologique et de traiter le deuil et le stress post-traumatique chez les survivants et les membres de leur famille. N'oubliez pas de prendre soin de leur santé mentale. »