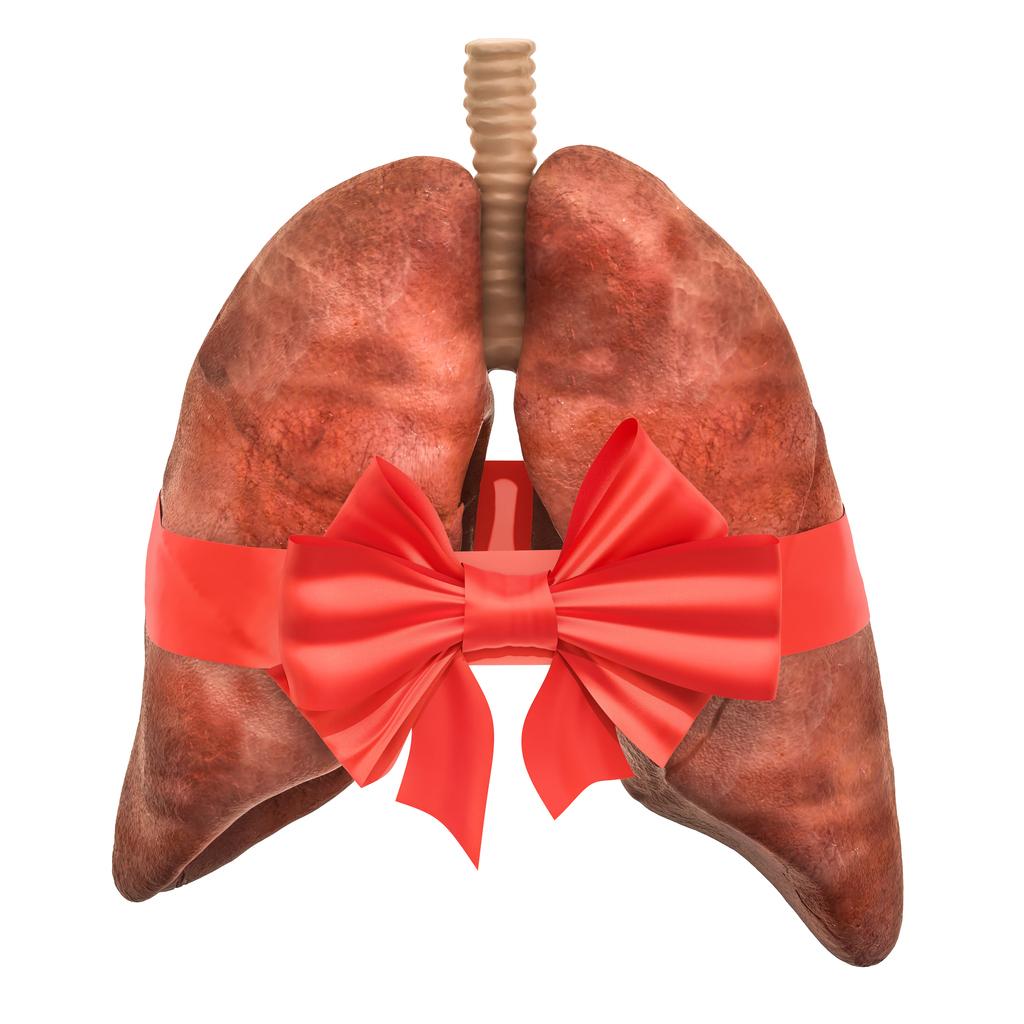Pneumologie
Hypertension pulmonaire à l'exercice, un marqueur prédictif associé à la mortalité.
La définition de l’hypertension pulmonaire d’effort a été remise à jour dans les guidelines de 2022 et constitue un facteur prédictif de mortalité, à l’issue du premier volet d’une étude rétrospective multicentrique internationale. Les résultats du second volet, prospectif, seront disponibles d’ici un à deux ans. D’après un entretien avec Laurent SAVALE.

Une étude, dont les résultats sont parus en décembre 2024 dans l’European Respiratory Journal, a cherché à obtenir des données plus précises sur la définition de l’hypertension pulmonaire d’effort et sur son caractère pronostique. Ce travail a été réalisé par un groupe d’experts, piloté par une équipe autrichienne et a utilisé le registre PEX-NET (Pulmonary Hemodynamics during Exercise Network), mis en place en 2018. Il s’agit d’une étude multicentrique internationale, composée de deux volets. Le premier volet, dont cette publication propose les résultats est un travail rétrospectif, qui a évalué 764 patients, dans 23 centres, ayant bénéficié d’un cathétérisme droit au repos et à l’effort. Les patients inclus avaient une pression artérielle pulmonaire inférieure à 25 mmHg au repos et ont été explorés à l’exercice. Ils ont été suivis pendant 6 à 7 ans. Le critère de jugement principal était la mortalité ou la transplantation, pour estimer la valeur pronostique des paramètres hémodynamiques au repos et à l’effort. Le second volet de ce travail est une étude prospective, qui est toujours en cours, et qui devrait permettre de valider ou non, définitivement, la définition des guidelines de 2022 comme marqueur pronostique.
Les guidelines de 2022 ont redéfini l’hypertension pulmonaire d’effort
Le professeur Laurent SAVALE, pneumologue au Centre de Référence de l’Hypertension Pulmonaire et dans le Service de Pneumologie et Soins Intensifs de l’Hôpital Bicêtre, et auteur de ce travail, explique que l’objectif de cette étude est d’obtenir des données plus précises sur l’hémodynamique à l’effort et notamment l’hypertension pulmonaire d’effort. Il rappelle, qu’en 2008, la pression artérielle pulmonaire était pathologique à l’exercice au-delà de 30mmHg. Mais, ce seuil s’est avéré insuffisant car il est dépendant de l’âge et des pathologies susceptibles d’être présentes au-delà de 50 ans. En 2022, les guidelines ont défini l’hypertension pulmonaire d’effort comme étant la pente de la pression artérielle pulmonaire moyenne sur le débit cardiaque supérieure à 3, à l’exercice. Cette définition a été établie à partir de petites séries rétrospectives et il était nécessaire d’obtenir des données multicentriques et à plus large échelle pour appuyer cette définition. A la lumière des résultats du premier volet de cette étude, Laurent SAVALE confirme que la valeur seuil de la pente ainsi définie est bien un facteur pronostic indépendant de mortalité.
Des résultats intéressants mais très théoriques
Laurent SAVALE émet cependant quelques limites à ces résultats. En effet, il précise qu’il peut exister des variabilités de méthodologie et ce paramètre, s’il est pris en compte isolément, ne permet pas de dire s’il s’agit d’une hypertension pulmonaire postcapillaire, qui signerait une cardiopathie gauche ou s’il s’agit d’une vraie vasculopathie pulmonaire avec une hypertension pulmonaire pré-capillaire. Il est impossible de distinguer les deux à la lumière de ces seuls résultats. D’autre part, Laurent SAVALE s’est interrogé sur le lien de causalité qui pourrait exister entre ce paramètre et la mortalité. L’analyse multivariée a bien montré que ce paramètre est associé à la mortalité mais cela reste très théorique et la discussion sur l’intérêt de traiter les patients à ce stade nécessite encore des investigations supplémentaires.
En conclusion, les résultats de cette étude, débutée avant 2022, valident bien le paramètre pression artérielle pulmonaire moyenne sur débit cardiaque supérieur à 3 comme prédictif de mortalité ou de transplantation. Toutefois, ces résultats ne permettent pas d’aller plus loin et de modifier les pratiques. Le second volet de l’étude apportera sans doute plus de précisions.


-1688721027.jpg)
-1686296101.jpg)