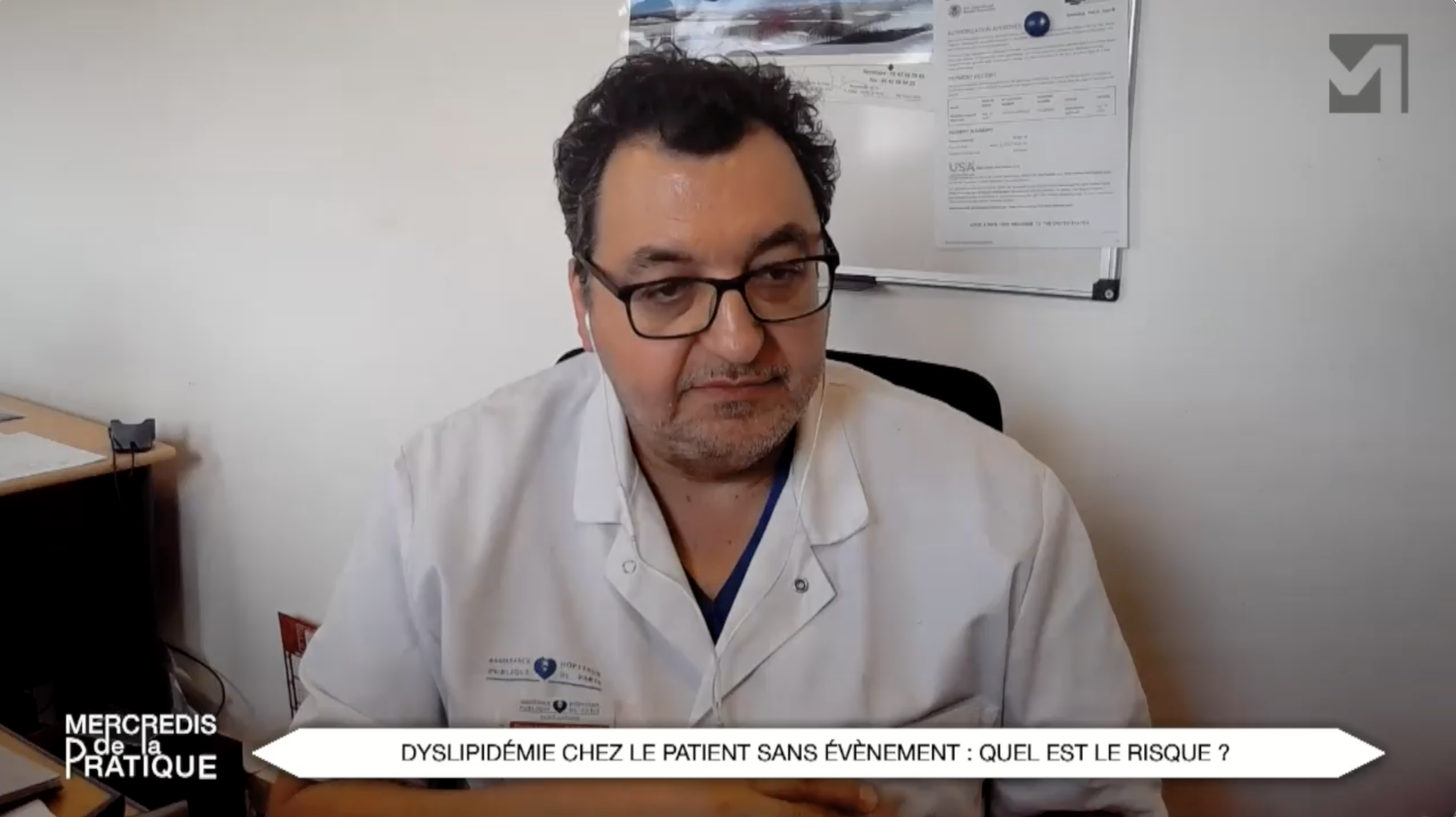Médecine générale
Chirurgie bariatrique : résultats comparés à 10 ans de la Sleeve et du By-pass gastrique
Une étude randomisée multicentrique suisse (SM-BOSS) a comparé la sleeve gastrectomie (SG) et le bypass gastrique « Roux en Y » (RYGB) chez des patients souffrant d’obésité sévère. Les résultats à long terme (≥ 10 ans) suggèrent un léger avantage du bypass pour la perte de poids, une meilleure maîtrise du reflux gastro-œsophagien et un taux de conversion inférieur.

- :mi-viri/istock
La chirurgie bariatrique est le traitement de référence de l’obésité sévère, notamment lorsqu’elle s’accompagne de comorbidités telles que le diabète de type 2 (DT2) ou l’hypertension artérielle. Devenue extrêmement populaire depuis deux décennies, la sleeve gastrectomie (SG) a rapidement dépassé le bypass gastrique « Roux en Y » (RYGB) en termes de nombre d’opérations chirurgicales réalisées. Toutefois, des données de suivi à long terme (au-delà de 10 ans) font état d’une reprise de poids notable et de l’apparition éventuelle d’un reflux gastro-œsophagien (RGO) de novo après sleeve.
Dans l’essai randomisé SM-BOSS, dont les résultats à 10 ans sont publiés dans JAMA Surgery, 217 patients ont été randomisés entre sleeve gastrectomie ou un RYGB. Après plus de 10 ans de suivi, les analyses en intention de traiter montrent une perte d’excès de poids (%EBMIL) moyenne de 60,6% pour la sleeve contre 65,2% pour le by-pass (p = 0,29). Le critère principal de jugement à 5 ans (pourcentage d’excès d’IMC perdu) ne montre pas de différence significative, mais la nouvelle analyse à 10 ans révèle un taux de conversion (nouvelle chirurgie) nettement plus élevé dans le groupe sleeve (29,9 % vs 5,5 % ; p < 0,001). Les motifs principaux de re-chirurgie après sleeve incluent un reflux gastro-œsophagien invalidant et une perte pondérale jugée insuffisante.
Avantage du By-pass Roux en Y à 10 ans
Lorsqu’on exclut les patients convertis à un autre type de chirurgie (analyse per protocole), le RYGB montre un avantage statistiquement significatif en %EBMIL par rapport à la sleeve (65,9 % vs 56,1 % ; p = 0,048). Toutefois, le pourcentage total de perte pondérale ne diffère pas significativement entre les deux groupes (27,7 % pour le RYGB vs 25,5 % pour la SG ; p = 0,37). Concernant le reflux gastro-œsophagien, un nombre significativement plus élevé de patients ayant eu une sleeve a déclaré un reflux de novo (p = 0,02).
Sur le plan métabolique, la rémission du diabète de type 2 à 10 ans atteint 61% après la SG et 71% après le RYGB, sans différence statistiquement significative. Le contrôle de la dyslipidémie et de l’hypertension artérielle est amélioré dans les deux groupes, sans écart notable. La tolérance globale reste bonne et comparable, mais l’incidence élevée de conversions après sleeve gastrectomie (repassant souvent en RYGB) indique que la sleeve gastrectomie peut s’avérer moins pérenne, en particulier chez les patients ayant un reflux ou une perte de poids insuffisante.
Un essai randomisé multicentrique sur 217 obèses sévères
L’étude SM-BOSS est un essai randomisé multicentrique suisse ayant inclus 217 patients recrutés entre 2007 et 2011. La répartition (SG vs RYGB) a été effectuée de manière aléatoire, et le critère principal initial concernait le %EBMIL à 5 ans. Bien que conçue pour évaluer le suivi à moyen terme, l’étude fournit ici des données à plus de 10 ans, avec un taux de suivi d’environ 65,4%. Les limites incluent donc une possible baisse de puissance statistique au long cours et un taux de crossover élevé (SG convertie en RYGB), reflétant cependant la réalité clinique.
Selon les auteurs, ces résultats confortent l’idée qu’un bypass gastrique offre un contrôle pondéral légèrement supérieur au-delà de 10 ans, ainsi qu’une meilleure prise en charge du reflux. Le taux important de conversions après une sleeve interroge quant à son choix initial chez les patients à risque de RGO.
Les études à venir pourraient s’attacher à mieux sélectionner les candidats à la SG selon leur profil métabolique et digestif, afin de réduire le risque de re-chirurgie. Par ailleurs, des essais contrôlés plus puissants seraient utiles pour évaluer finement l’impact à long terme des deux procédures sur la rémission du DT2, la mortalité cardiovasculaire et la qualité de vie, y compris dans des populations plus diversifiées (IMC >60, multimorbidités graves, etc.).