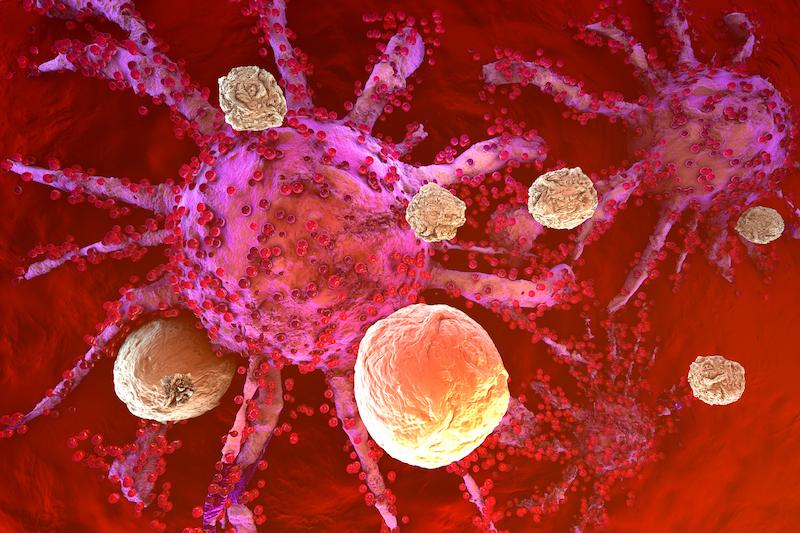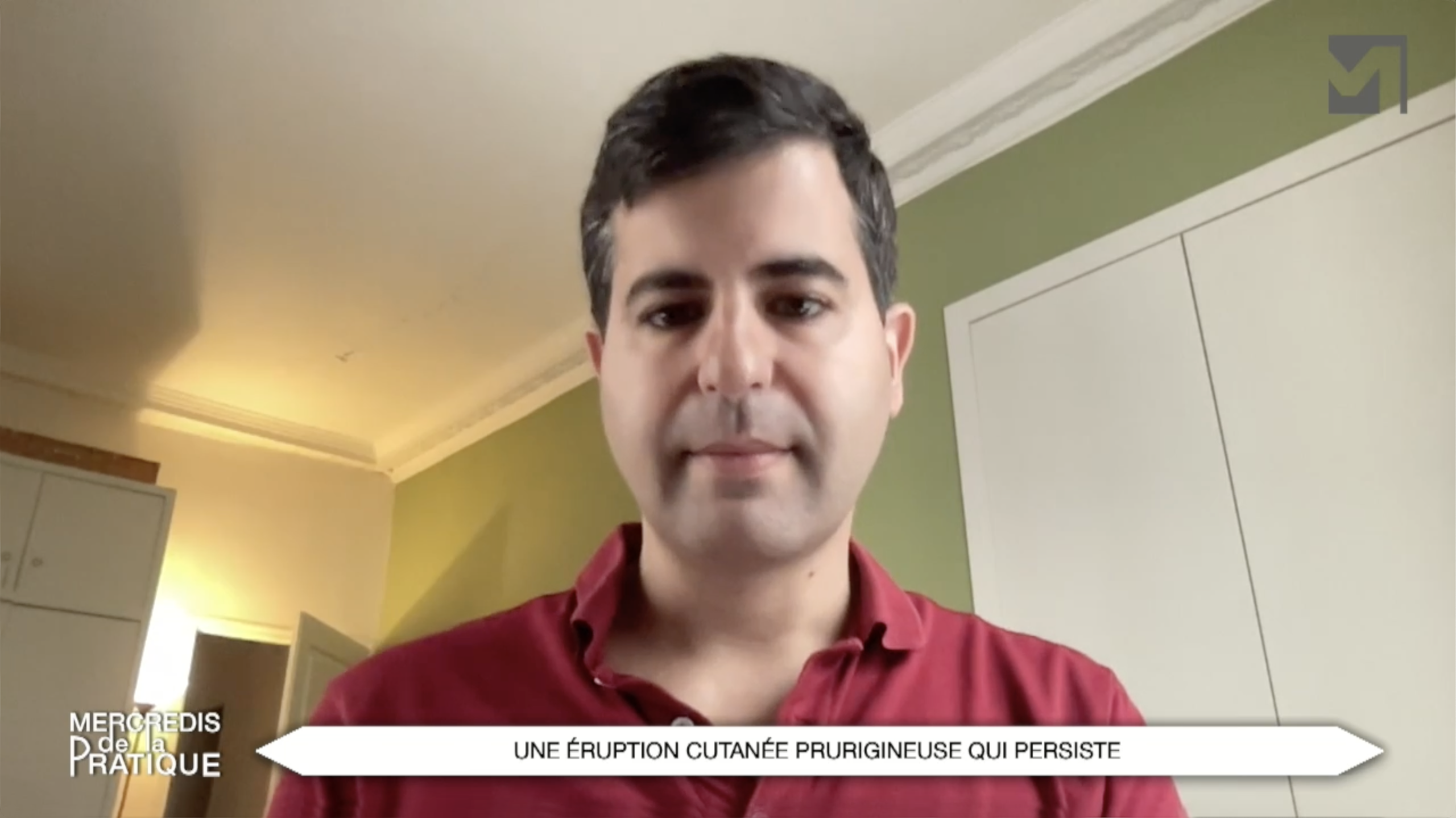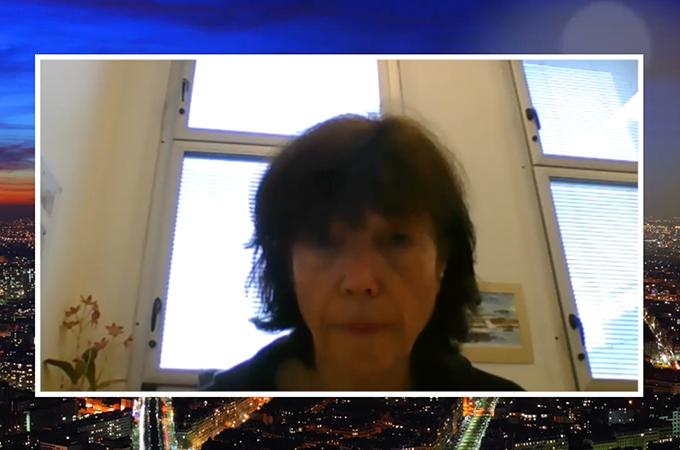Dermatologie
Carcinomes cutanés : rôle préventif des immunothérapies sur le champ de cancérisation ?
Les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire (ICIs), déjà incontournables dans le traitement de certains cancers avancés, pourraient freiner la progression des lésions cutanées précancéreuses, notamment les kératoses actiniques, vers les carcinomes épidermoïdes cutanés. Une étude pilote suggère un effet immunopréventif sur la carcinogénèse cutanée, mais le rapport bénéfice-risque reste à évaluer.

- pedrojperez/istock
Les kératoses actiniques sont des lésions précancéreuses courantes qui, sur fond de champ de cancérisation photo-induit, peuvent évoluer en carcinome épidermoïde cutané : 0,01% à 0,025% par année-lésion mais 16% à 20% lorsqu'un patient a plus de 20 kératoses actiniques, reflétant le concept de « champ de cancérisation ». Or, les approches conventionnelles (exérèse chirurgicale ciblée, traitements topiques) ne suffisent pas actuellement à endiguer la survenue de nouvelles lésions.
Les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire (ICIs), notamment les anti-PD-1 ou anti-PD-L1, sont déjà utilisés dans divers cancers métastatiques. Cette étude de cohorte prospective, réalisée dans un hôpital tertiaire en Australie, a inclus 23 patients immunocompétents démarrant un traitement par ICI pour un cancer actif (durée prévue ≥6 mois). Au départ, chaque participant avait également des lésions cliniques de kératoses actiniques sur les avant-bras.
Selon les résultats de l’étude, publiés dans JAMA Dermatology, après un an de suivi, le nombre moyen de kératoses actiniques est passé de 47,2 à 14,3, correspondant à une baisse significative (p < 0,001). Quant au nombre total de carcinomes cutanés diagnostiqués, il a diminué de 42 à 17 entre les 12 mois précédant et suivant l’instauration de l’ICI, dont une baisse de 16 à 5 pour les carcinomes épidermoïdes cutanés. Bien que cette réduction des carcinomes ne soit pas significative, ces données suggèrent l’existence d’un effet immunomodulateur sur le champ de cancérisation, ouvrant la voie à une immunoprévention potentielle pour des patients à haut risque de cancers cutanés.
Efficacité préventives majorée dans certaines populations à risque
En examinant plus finement la population, il apparaît que certains facteurs pourraient amplifier encore la réponse. Les patients plus jeunes ou ayant un historique de « coups de soleil bulleux » ont eu davantage de régression des kératoses actiniques (diminution ≥65 %). Ces constatations recoupent l’idée qu’un passé d’expositions solaires sévères accroît le fardeau mutagène et peut favoriser la réponse immunitaire sous ICIs.
D’autres traitements de champ (fluorouracile, photothérapie dynamique, nicotinamide….) ont déjà prouvé leur efficacité, parfois avec des taux de régression des kératoses actiniques supérieurs à 70%. Cependant, la comparaison demeure délicate : en l’état, l’impact des ICIs en prévention des carcinomes épidermoïdes cutanés est prometteur mais pourrait être grevé par un profil de tolérance plus lourd.
Dans la présente cohorte, la majorité des effets indésirables restait cutanée, sans signal de toxicité inattendue, reflétant les connaissances déjà établies sur les ICIs (30 à 60 % d’effets indésirables dermatologiques décrits dans la littérature). Quatre patients sont décédés en cours d’étude, non pas d’effets secondaires immunologiques mais de la progression de leur pathologie cancéreuse.
Un travail prospectif « proof of concept » à confirmer et réévaluer
Ce travail, mené de façon prospective, reposait sur un suivi clinique rigoureux à 3, 6 et 12 mois, avec comptage photographique des kératoses actiniques et collecte rétrospective des comptes-rendus anatomopathologiques. La représentativité demeure toutefois limitée par la taille modeste de l’échantillon (23 patients), l’hétérogénéité des cancers sous-jacents et la possibilité de régression spontanée de certaines kératoses actiniques. Par ailleurs, le mode de recrutement (patients déjà éligibles à une immunothérapie oncologique) peut biaiser l’extrapolation vers l’immunoprévention spécifique chez des sujets n’ayant pas d’indication première aux ICIs.
Selon les auteurs, ces résultats préliminaires suggèrent que, chez des personnes fortement exposées aux rayons UV et à risque majeur de carcinomes épidermoïdes cutanés ou de carcinomes basocellulaires multiples, l’initiation d’une immunothérapie pour un cancer pourrait se traduire par un effet protecteur additionnel au niveau du champ de cancérisation cutané. Toutefois, le coût élevé et les risques immunologiques (hépatite auto-immune, endocrinopathies) imposent cependant une sélection précise des patients et une évaluation rigoureuse du rapport bénéfice-risque.
Il est nécessaire de prévoir des essais contrôlés plus vastes et plus longs, ciblant précisément les patients à très haut risque de carcinomes cutanés, qui seuls permettront de déterminer si cette piste d’immunoprévention est soutenable et plus intéressante que les stratégies de chimio-prévention existantes. Des travaux complémentaires pourraient explorer la durabilité de l’effet des ICIs après arrêt du traitement, ainsi que le rôle des facteurs individuels (génotype, antécédents solaires, phototype) dans la modulation de la réponse thérapeutique.